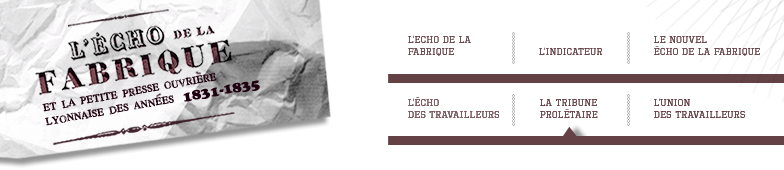|
|
25 janvier 1835 - Numéro 19 |
|
|

|
|
| |


|
AMÉLIORATION INDUSTRIELLE. 6e article. (Voir les 5 numéros précédens) [1.1]Travailleurs ! Nous vous avons fait connaître votre véritable situation dans l’ordre industriel et commercial. L’examen dans lequel nous sommes entrés pour cela, nous a servi à constater la source où prend naissance l’oppression qui vous écrase. Après avoir sondé le côté où vous êtes faibles et celui par où vous êtes forts, nous vous avons excités à combattre les mauvais effets de la concurrence illimitée. Vous avez bien compris, n’est-ce pas, que lorsque sous la garantie de la publicité le bénéfice commercial sera soumis à une répartition, dans laquelle vous ne serez pas oubliés, qui sera fixée à l’avance et modifiable toutes les fois que l’expérience le démontrera convenable ou nécessaire. Vous avez compris que la franchise et l’équité auront bientôt pris la place de la fraude et du mensonge qui rendent si peu agréables les rapports que les hommes ont entre eux. Eh ! grand Dieu ! comment serait-il possible qu’une véritable bienveillance existât entre nous, lorsque tout contribue à nous tenir divisés comme des ennemis, quand chaque instant de la vie est empoisonné par l’appréhension d’être trompés, appréhension qui nous force de nous tenir en garde contre ceux-là même auxquels nous donnons le nom d’amis. C’est donc bien sérieusement qu’il nous faut songer à fonder un ordre de choses qui établisse une communauté d’intérêts entre les diverses classes commerçantes et laborieuses, afin que peu à peu la fraternité universelle ne soit plus un vain mot sortant sans écho de la bouche des hommes ! Obéissons à ce sentiment intérieur qui nous fait désirer comme un besoin de notre existence de voir une douce harmonie présider à toutes nos relations, et remplacer cette défiance jalouse et soupçonneuse, qui rend la vie semblable à un fardeau pesant. Mais ne dépensons pas tout notre temps en phrases sentimentales : hâtons-nous d’arriver au positif. Nous avons dit ce que nous devions exiger du commerce et nous sommes restés d’accord que la publicité est la condition que nous devons exiger avec plus d’instance ; car elle est à la fois la garantie de tous les autres avantages et un moyen pour les obtenir. Nous avons été jusqu’à dire quelle devait être la proportion allouée à chaque classe dans la répartition du bénéfice social, et nous l’avons divisé de manière à concilier [1.2]tous les intérêts qui se trouvent en présence. Mais en cela, n’avons-nous pas ressemblé un peu aux chasseurs de la fable, qui se partagent la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Suffira-t-il que vous disiez au marchand de transformer le système par lequel est gérée sa maison pour qu’il le fasse ? Vous servirez-vous du raisonnement, et chercherez-vous à le persuader que son intérêt s’accorde avec ce que vous lui demandez ? J’ai bien peur que le marchand vous rie au nez et ne vous écoute que par complaisance, sans chercher le moins du monde à vous comprendre ; car voyez-vous, le marchand n’est pas fort sur ces questions d’amélioration sociale : il ne s’en occupe nullement. Il ne lit pas l’Indicateur, lui ; comment voudriez-vous qu’il vous comprit, surtout lorsque vous lui demandez d’entrer en participation de ses bénéfices ; vous pouvez facilement vous imaginer combien il se récriera à ces propositions. Il vous comprendra encore bien moins lorsque vous lui direz que la société a besoin de fréquentes exhibitions de ses livres ; que désormais, dans le commerce, il ne doit y avoir rien de caché pour les travailleurs représentés par un certain nombre d’hommes ayant la confiance du peuple. Soyez sûrs qu’à ce propos ils jetteront les hauts cris, et tout en protestant contre la violation de la liberté qu’ils se donnent d’exploiter le public, beaucoup craindront en outre que leurs fournisseurs ne leur refusent leur confiance, s’ils parvenaient jamais à connaître sur quels capitaux factices roulent leurs affaires. Un grand nombre trembleront que cela ne leur fasse faire banqueroute trop tôt ; c’est-à-dire avant le temps fixé pour qu’elle soit plus productive pour eux et plus désastreuse pour leurs créanciers. Non, travailleurs, lorsque nous vous avons dit que vous pouviez exiger toutes ces choses, nous n’avions pas cru nous-mêmes qu’il y consentît. Il faut convenir d’ailleurs qu’il y a bien des difficultés à vaincre, bien des répugnances à surmonter de la part du marchand, pour qu’il se décide à satisfaire aux réclamations publiques. La vieille habitude d’agir sans aucun contrôle de mentir, de tromper, sans qu’une voix un peu forte s’élève pour le lui reprocher ; et aussi l’esprit de routine empêcheront probablement long-temps encore les hommes ordinaires dont est composé le commerce, de changer de système. Faudra-t-il donc les attendre et nous borner pendant des siècles peut-être à demander à l’homme égoïste et routinier, de bien vouloir prendre en considération nos plaintes sur sa mauvaise foi. Oh ! je crois que nous risquerions bien d’attendre jusqu’à la fin du monde. Travailleur ! aide-toi, le Ciel t’aidera, voilà une vieille devise qui est de tous les temps ; ne l’oublions pas et en [2.1]dépit de cette résistance inerte, sur laquelle nous devons d’avance compter, nous obligerons moralement le négoce de céder devant la justice de nos projets améliorateurs. Puisqu’il est décidé que c’est sur le terrain du négoce qu’il faut prendre position ; puisque c’est par un premier établissement de vente sociale qu’il faut commencer la guerre pacifique de notre émancipation industrielle, voyons donc par quel genre de commerce il faut débuter et quelle espèce de marchandises il faut se charger de distribuer d’après le nouveau mode commercial. Si vous voulez que bientôt un exemple mémorable ait lieu, un exemple dont le retentissement soit tel que devant lui, le parlage des partis politiques ne devienne plus qu’un imperceptible et vain murmure. Faites que sous la responsabilité d’un homme de bonne volonté, possédant d’ailleurs toutes les garanties nécessaires ; faites qu’une vente sociale d’épicerie s’établisse… On aura beau sourire à cette idée de l’épicier devenant tout à coup l’homme le plus avancé du siècle et malgré son burlesque surnom, être subitement transporté à la tête de la civilisation. Il n’en est pas moins vrai que ce fait à lui seul aura plus d’importance pour l’avenir de l’humanité, que mille de ces événemens insignifians ou funestes qui, faute d’autres, fixent l’attention des gens à courte vue. Si nous proposons l’épicerie, ce n’est pas dans une idée exclusive des autres genres de marchandises, mais seulement parce que nous croyons que cette partie présente des convenances qui la rendent préférable pour l’essai ; quoiqu’il en soit de cette préférence, vous êtes déjà à même de concevoir qu’en s’y prenant ainsi le succès est certain. Oui, travailleurs, en votre qualité de consommateurs tout ce que vous voudrez de bien sera ; tout ce que vous aurez reconnu juste et utile s’effectuera, si vous le désirez d’une manière active et si vous avez confiance en quelques-uns de vos frères qui ne vous ont jamais trompés ; ce sont eux qui dans ce moment vous disent : « Vous aurez beau désirer un avenir meilleur et vous plaindre du présent avec tant et plus d’amertume, le présent restera ce qu’il est et l’avenir lui ressemblera, si vous ne faites rien pour qu’il change. Vous voulez combattre le mauvais usage de l’argent ; ce n’est qu’avec de l’argent que vous pourrez le vaincre. Il en faut peu il est vrai, mais encore il en faut ; c’est la seule artillerie avec laquelle on puisse enfoncer ses rangs… Ecoutez !… nous sentons tout ce qu’il y a de défavorable et de pénible à venir dire aux travailleurs : Vous souffrez, n’est-ce pas ? vous êtes bien malheureux. Une crise industrielle terrible vous abîme en ce moment même. Eh bien ! nous vous le disons, c’est justement à cause de cela et malgré cela, qu’il faut trouver encore quelques francs pour fonder votre avenir et mettre enfin un terme à vos maux. Dans le temps où nous sommes, rien ne se fait avec rien : si vous voulez recueillir, il faut absolument semer. Si vous voulez entrer en participation dans les millions que gagne le commerce, il faut faire quelques avances pour fonder le premier établissement, qui bientôt envahissant le commerce à votre profit et à celui de vos enfans, se multipliera plus nombreux que les étoiles du ciel ! Il le faut ; car si vous ne vous intéressez vous-mêmes à votre affranchissement, qui donc s’y intéressera ? Il le faut ; car c’est le seul moyen de montrer d’une manière évidente que vous avez compris ce qu’il y a à faire, et que vous êtes prêts à seconder de votre puissant concours celui qui, reconnu le plus digne, osera défier les abus du commerce et se placer en dehors de ses habitudes de fraude. Il est donc absolument indispensable qu’une manifestation de votre adhésion ait lieu pour susciter un homme capable et de bonne volonté, pouvant vous offrir une vie sans tache, une probité éprouvée ainsi que quelques mille francs gagnés honorablement. Eh bien ! que quelques capitaux soient réunis pour s’ajouter aux siens, et nous sommes certains que cet homme se trouvera. Voilà, travailleurs, ce que nous vous conseillons dans notre zèle pour l’amélioration sociale. Or, il ne s’agit pas, comme vous voyez, de braver le gouvernement, de lutter contre les lois ; toutes choses coupables que nous ne vous conseillerons jamais de faire. Mais il s’agit de former, par [2.2]souscription un premier fonds social destiné à garantir les prêteurs de capitaux de toute chance de perte, et de vous préparer vous-même à profiter, comme capitaliste, de la sécurité que vous aurez assurée par ce moyen. A présent, le reste dépend de vous : nous avons rempli une partie de notre tâche. A vous maintenant de savoir ce que vous devez faire. Si vous n’êtes pas mécontens, si votre situation vous paraît supportable, ne vous remuez pas, et sûrement vous ne verrez rien changer, si ce n’est en pire ; si la confiance vous manque, si vous n’en avez ni en vous-même ni en personne. Oh ! alors, nous n’hésitons pas à vous le dire, vous êtes perdus ! Mais si, comme nous le croyons, parce que nous sommes des vôtres et que nous connaissons vos sentimens généreux, vous êtes pénétrés du besoin de contribuer à créer un avenir meilleurs, mettez-vous à l’œuvre et que chacun, en son particulier, fasse dans sa sphère et selon ses moyens, tout ce qu’il pourra. Quoique nous soyons isolés par le seul fait de ce lien moral résultant d’une intention commune, on peut faire de grandes choses. Pour nous qui nous sommes établis, vos interprètes et vos conseillers, nous vous aiderons de toutes nos forces. Nous continuerons de développer, d’éclaircir les questions de réformes toutes les fois que besoin sera. Nous ouvrirons nos colonnes à toutes les explications nécessaires et nous y enregistrerons les listes des souscripteurs, à mesure qu’elles nous seront communiquées. Nous ne terminerons pas toutefois cette série d’articles réformateurs, sans adresser à nos concitoyens cette dernière exhortation. Notre ville s’est assez distinguée dans la carrière belliqueuse. Nul n’a le droit de contester à ses habitans le funeste courage des combats ! Méritons une autre gloire plus pure et plus douce ; au lieu de le faire trembler, sauvons le monde de la misère, et que par nous Lyon soit célébré en accens d’allégresse par l’univers reconnaissant ! (Fin.) M. D.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL. (Présidence de M. Delandine.) Audience du 22 janvier. Nos lecteurs qui ont lu notre profession de foi, se rappellent sans doute que nous ne voulions pas faire de la politique ; aussi nous ne fournîmes point de cautionnement. Malgré notre extrême modération, nous avons eu aujourd’hui à répondre par-devant le Tribunal correctionnel pour des articles soit disant politiques. M. le substitut Belloc, après avoir lu et relu les discours des membres de la Chambre des députés qui votèrent la loi du 28 juillet 1828, qui affranchit du cautionnement les journaux étrangers à la politique, il a conclu à l’application de l’art. 6 de la loi de 1819. M. Jules Favre, défenseur de notre Gérant, s’est exprimé en ces termes : Il y a quatre mois à peine que le gérant de l’Indicateur était traduit aux pieds de votre tribunal, comme prévenu d’avoir renoué les liens brisés de l’association mutuelliste ; alors, et malgré la vive insistance du ministère public, il fut démontré que cette résurrection prétendue n’était qu’un fantôme ridicule, dont les terreurs de la police avaient jeté l’ombre complaisamment grandie aux avidités réquisitoriales du parquet. Il fut démontré que les conciliabules mystérieux dénoncés par l’intelligente sagacité des agens municipaux, n’étaient que de paisibles réunions d’actionnaires, dans lesquelles, au lieu de poignards sur lesquels on aurait reçu d’homicides sermens, on n’était armé que d’innocens couteaux de bois destinés à découper des prospectus plus innocens encore. Cette mystification qui cependant émut notre ville, en y réveillant de funèbres souvenirs, devait se terminer par l’acquittement des prévenus. Votre justice alla plus loin. Elle ne se tint pas pour satisfaite de la solennité de cette réparation. Elle voulut bien y ajouter de bienveillantes paroles d’encouragement pour l’entreprise à laquelle M. Favier s’était généreusement voué. J’entends encore de la bouche du magistrat qui dirigeait ces débats, tomber de paternelles exhortations dans lesquelles il proclamait lui-même l’utilité d’une feuille consacrée à la défense des intérêts humbles et précieux des classes laborieuses. Les temps seraient-ils changés, qu’aujourd’hui nous sommes de nouveau forcés de [3.1]lutter contre les sévérités de la loi, et qu’au tribunal même il daignait nous soutenir, chancelans que nous étions au début de notre carrière, on réclame contre nous une condamnation ? Et que nous reproche-t-on ? D’avoir follement usurpé un rôle qu’à défaut de la loi notre obscurité semblait devoir nous interdire ; d’avoir mêlé nos plaintes d’atelier aux grandes et fortes voix qui retentissent au travers des tempêtes politiques. Oserais-je le dire, Messieurs, le ministère public sait le premier la vaine élasticité de ces accusations, et j’ai de ses lumières une estime trop vraie, pour supposer un instant qu’il pense solliciter de votre justice la répression d’un délit. Non, c’est la suppression d’un journal que je lis dans les conclusions de son réquisitoire, c’est une guerre systématique déclarée aux feuilles qui font descendre dans les rangs populaires l’instruction et l’espérance d’un avenir meilleur. Autrement, pourquoi ces attaques de détail et ces récriminations tardives ? pourquoi choisir la Tribune Prolétaire comme première victime, et se faire de l’arrêt de la cour une position favorable pour frapper l’Indicateur ? pourquoi cette vigilance posthume qui, par je ne sais quelle rétroactivité de prudence, recherche des numéros publiés depuis long-temps et que le silence du ministère public semblait avoir absous ? pourquoi surtout cette rigueur privilégiée contre un organe grave et modéré, dont la bonne foi n’est pas suspectée, tandis qu’on réserve toutes les tendresses de son indulgence pour les turpitudes juridiques et les nouvelles controuvées, que chaque matin les crieurs jettent en pâture à la crédulité de la rue ? Vous l’avez deviné. C’est qu’on en veut finir avec ce qu’on appelle la presse populaire. C’est que le temps semble venu d’écraser toute pensée indépendante et tout progrès inférieur : c’est que nos gouvernans ont cru poser les colonnes d’Hercule, et que leurs procureurs jugent digne de prison quiconque essaierait de les reculer. Voilà pourquoi aussi aux légitimes et naturelles anxiétés de la défense se joignent encore dans notre ame les murmures involontaires d’une révolte intérieure que nous aurions mal cherché à déguiser. Voilà pourquoi nous nous sentons saisis d’un découragement profond et accablant qui nous dominerait si nous ne savions que dans ces combats judiciaires l’avantage n’est pas toujours du côté de l’apparente victoire ; si nous n’avions foi en votre justice qui, dans des circonstances plus graves et plus décisives, ne nous a pas manqué. Nous l’invoquons aujourd’hui avec d’autant plus de confiance que nous avons la conviction intime, je ne dis pas d’être restés dans les limites de la loi, mais de n’avoir fourni aucun prétexte, pour qu’on nous puisse accuser d’en être sortis. Mais puisque la raison d’état plutôt que la légalité a dicté cette poursuite, puisqu’on nous attaque plutôt comme propagateurs de doctrines que comme violateurs de textes, nous aurons une double tâche à remplir. Nous prouverons d’abord que nous n’avons pas violé la loi, ce qui est beaucoup ; ce qui est davantage, que nous sommes dans notre modeste sphère un élément d’ordre et de stabilité. Ainsi nous repousserons les reproches patens et les hostilités secrètes de la plainte, et nous préparerons notre acquittement devant le tribunal, notre justification devant l’opinion. Ici Me Favre fait une analyse rapide des lois de 1819. Il prouve qu’elles ne sont applicables qu’aux journaux politiques ; or, l’Indicateur est une feuille essentiellement industrielle et prouve avec évidence que la loi ne peut pas l’atteindre et que d’ailleurs les chefs d’atelier ne l’ont créée que comme centre d’indication et de travail, car il n’a jamais élevé ses idées jusqu’à la politique. Mais faut-il aller jusqu’à dire que les sciences morales sont défendues aux feuilles non cautionnées ? La loi, loin de le prononcer, a disposé le contraire. Le paragraphe 3 de l’article 4 de la loi de 1828, affranchit du cautionnement les journaux exclusivement consacrés aux lettres ou aux autres branches de connaissance, non spécifiées ci-dessus. On argumente de la discussion qui a eu lieu devant la chambre des députés. Elle a prouvé que le gouvernement désirait imposer l’entrave du cautionnement à tous les journaux, que l’opposition a demandé grâce pour ceux qui ne traitaient pas de politique : en introduisant dans la loi un texte aussi large que celui du paragraphe 3, la chambre n’a pas entendu admettre l’opinion des ministres. La discussion des sciences morales n’entraîne donc pas la nécessité du cautionnement, et l’on devrait se réjouir de les voir se populariser en se séparant des disputes irritantes des partis. L’avocat représente quelques considérations sur l’avenir de notre industrie et la nécessité de la réformer pacifiquement, et ajoute que si le parquet avait attendu 15 jours à nous faire paraître devant le tribunal, on aurait vu que notre prétendue politique des articles les plus surchargés, n’aboutissait qu’à l’établissement d’une boutique d’épicerie, M. Jules Favre termine ainsi : Ces pensées élevées se seraient naturellement présentées à vos esprits : pour moi, je dois laisser la pente rationnelle qui m’y a conduit, pour vous soumettre en finissant des réflexions plus humbles et plus personnelles à mon client. En effet, quoique cette discussion ait forcément soulevé des principes fondamentaux, elle doit se résumer par une application spéciale et qui peut-être rigoureuse. L’homme qui est à vos pieds sera-t-il frappé en holocauste d’une idée, expiera-t-il par la prison le dangereux honneur d’avoir été le représentant d’une thèse générale ? Solennelle et terrible question que trop souvent on sépare de l’examen de la [3.2]bonne foi et de la culpabilité morale. Vous, messieurs, vous ne ferez pas cette inique distinction. M. Favier n’a pas violé la loi, je l’ai prouvé ; eut-il, par mégarde et à son insu, laissé passer un mot de politique dans ses discussions industrielles, vous ne lui infligerez pas pour ce fait une sévère punition. Vous ne l’arracherez pas à son travail à un moment où les ouvriers en ont si fort besoin, où le salaire de chaque jour suffit à peine aux nécessités du lendemain. Et quant à l’Indicateur, averti par les poursuites de M. le procureur du roi, il sera prudent ; il ne se permettra pas une phrase qui ressemble à la politique. Mais il persévérera dans ses enseignemens industriels ; car tel est son droit, et c’est autant pour en obtenir la consécration légale, que pour repousser une condamnation qui opérerait sa ruine, qu’il a invoqué avec confiance la justice de vos décisions. Après avoir entendu de courtes répliques du ministère public et du défenseur, le tribunal renvoie la cause à mercredi prochain, pour prononcer son jugement.

CONSEIL DES PRUD’HOMMES.
Audience du 22 janvier. présidence de m. putinier. Sur vingt-une causes appelées, six ont été renvoyées, quatre ont fait défaut et sept ont été retirées. Un apprenti qui ne remplit pas sa tâche, fait constaté par un membre du conseil sous la surveillance duquel avait été mis l’atelier, le père est-il passible de ce déficit ? – Oui ; et dorénavant au lieu de laisser accumuler les arriérés, ils seront payés à la fin de chaque pièce. Ainsi jugé entre Renaud, chef d’atelier, et Joband, apprenti. Lorsqu’un maître, par l’insubordination de son élève et sa mauvaise fabrication, demande à résilier les conventions, le père doit-il payer sur le champ les arriérés des tâches ? – Oui. Et si l’apprenti, au lieu de finir son temps comme tel dans un autre atelier ou se mettait compagnon et même maître, le chef d’atelier rentre dans tous ses droits. Ainsi jugé entre Neyron, chef d’atelier, et Labarié, apprenti. Lorsqu’un négociant a fait monter un métier et qu’il ne l’occupe pas, fait constaté dans une précédente audience où il avait été condamné à donner une pièce de suite, sous peine d’amende ; s’il n’accomplit sa promesse, est-il passible du défrayement ? – Oui ; attendu que le chef d’atelier s’est hâté de le mettre en demeure pour certifier son temps perdu. Ainsi jugé entre d’Hautancourt, Garnier et compagnie, négocians, et Vivant, chef d’atelier. Lorsqu’un maître se permet de négliger son élève à tel point qu’au bout de 15 mois elle n’a pas encore son métier, l’atelier est-il mis sous la surveillance ? – Oui ; vu que le maître était dans ses torts, n’ayant pas de raisons valables pour justifier sa négligence, il devra donner de suite un métier à son élève. Ainsi jugé entre Rivat, chef d’atelier, et Rosier, apprentie. Un apprenti qui se met constamment en arrière de ses tâches, est-il mis sous la surveillance ? – Oui. Les arriérés seront payés de suite, et si l’élève ne se corrige pas et continue à mal faire, le père sera passible de la mauvaise fabrication de son fils, et les engagemens seront résiliés avec indemnité. Ainsi jugé entre Ratton, chef d’atelier, et Bourgeon, apprenti. Lorsqu’un chef d’atelier est obligé de faire appeler son élève pour la troisième fois, vu que par sa mauvaise fabrication, constatée par un membre du conseil, il ne peut plus l’occuper, les engagemens sont-ils résiliés ? – Oui : le maître reçoit une indemnité, et l’apprenti ne pourra se replacer qu’en cette qualité. Ainsi jugé entre Mallan, chef d’atelier, et Murat, apprenti. Dans l’affaire de Malleval, chef d’atelier, et Billon, Candy, négocians, qui a été renvoyée pour vérification au sujet d’un rabais, M. Candy a dit à l’audience qu’il pouvait bien faire supporter un rabais à M. Malleval, vu que trois autres chefs d’atelier, dont les pièces n’étaient peut-être pas aussi inférieures, avaient consenti à perdre toute leur façoni. [4.1]Si le fait est réel, ce que nous ne pouvons croire, nous avertissons ces chefs d’atelier qu’ils sont tout-à-fait dans leur tort, parce que par-devant le conseil on n’a jamais décidé qu’une pièce entière serait sans façon ; ils perdent par leur faute au moins la moitié du prix qui aurait pu leur être alloué. Lorsqu’un apprenti s’évade de chez son maître, ce dernier a-t-il le droit de ne le plus reprendre chez lui ? – Oui : mais il fera délivrer un livret à l’apprenti, vu qu’il n’a plus que six mois à faire et qu’il a déclaré au conseil qu’il savait travailler. Ainsi jugé entre Poly et Chapelle. Dans cette affaire le conseil a commis une erreur que nous ne pouvons laisser passer inaperçue. Sa décision est contraire à sa jurisprudence, et nous ne concevons pas qu’il ait pu, après que l’apprenti s’est enfui furtivement de chez son maître, le rendre libre sur le refus qu’a fait le chef d’atelier de le reprendre, et qu’avant l’expiration du temps d’apprentissage, il ait imposé à ce dernier de lui faire avoir un livret. Un tel jugement peut avoir de funestes conséquences ; car alors un apprenti n’aura plus, pour devenir compagnon, qu’à faire des escapades de nature à décourager son maître de le garder. L’élasticité du conseil ne doit pas aller jusque-là, autrement où en serait la sécurité des droits des chefs d’ateliers.
i. Ici, le langage de M. Candy est tout-à-fait déhonté, il est stupide même : car moi, si je consens à travailler gratis pro Deo, les autres chefs d’atelier de ce magasin seront-ils contraints d’être aussi fous que moi ?… Oh ! non assurément.

M. Arlès Dufour, négociant-commissionnaire de notre ville, dont le nom et les sentimens philanthropiques nous sont si connus, vient de livrer à la publicité un ouvrage remarquable au sujet des fabriques étrangères de soirie1, dans lequel il compare leur situation à celle des fabriques de Lyon, fait l’historique de leur décadence ou de leur progrès, en ayant soin d’indiquer les causes de l’un ou de l’autre de ces effets. On conçoit qu’elle doit être l’importance d’un ouvrage de ce genre, fait par un homme que sa position dans le commerce, ses voyages fréquens et ses nombreux correspondans, ont mis à même de traiter cette question avec connaissance de cause. Aussi cette brochure est un assemblage de documens rares, de tableaux statistiques extrêmement importans, de renseignemens d’autant plus précieux que le caractère de l’auteur ne permet pas d’en suspecter l’exactitude. Dès la lecture des premières pages, on est étonné des idées larges et élevées qui ont présidé à sa rédaction, et plus on avance, plus on sent que l’auteur n’a eu en vue que de se rendre utile à ses concitoyens. Nous aurons donc souvent à le consulter dans l’intérêt de l’industrie. Pour aujourd’hui, nous nous contenterons de remercier M. Arlès Dufour d’avoir pensé à la société, lorsque tant de monde et surtout tant de négocians comme lui, ne pensent qu’à leur seul intérêti.
i. Nous n’oublierons pas de dire que le produit de la vente a une destination toute sociale, puisqu’il contribuera à ériger un monument à Jacquard, une des célébrités de notre siècle. Chez M. Bohaire et Mme Durval. Prix : 3 fr. 50 c.

VARIÉTÉS.
projet d’association dans la marine française. Tableau des clubs et associations dans la marine royale d’Angleterre. A une époque où l’on cherche si sagement à faire naître parmi nous l’esprit d’association ; au moment où l’on s’occupe partout de banque de prévoyance, de caisse d’épargne, de salle d’asile, institutions que l’on ne saurait trop encourager, nous croyons devoir présenter à nos lecteurs le tableau des clubs ou associations bienfaisantes de la marine royale anglaise ; tous fondés et soutenus par les propres moyens et les souscriptions volontaires des officiers qui les composent. Ce tableau en dit plus que les dissertations les plus éloquentes. Quels hommes ont plus besoin de se serrer fraternellement pendant leur vie, de [4.2]songer à l’avenir de leurs familles, que les enfans de la mer, que ceux qui vivent au sein des tempêtes ? Nous voudrions qu’en France, depuis l’amiral jusqu’au matelot ; depuis le capitaine au long cours jusqu’au pilotin, tout le monde se cotisât pour établir des sociétés pareilles, car leur but est aussi honorable qu’il est utile. Olduaval, club établi il y a vingt ans. On y déjeûne, on y dîne ; on y passe la soirée jusqu’à minuit. On y trouve les journaux, les ouvrages périodiques et livres nouveaux. Il y a salle de réception, billard, bibliothèque, cabinets de toilette et papier pour écrire sa correspondance. Ce club comprend 500 membres, depuis le grade d’amiral jusqu’à celui de commandeur. Chaque membre a le privilége d’introduire, par invitation, un officier étranger de terre ou de mer, de même grade, pendant son séjour à Londres. La souscription annuelle est de 5 guinées ou 125 fr. Naval amicable society. – Ce club est tout philantropique et soutenu par la majorité de la marine. La souscription annuelle pour un amiral est de 25 fr., pour un capitaine de vaisseau 12 fr., pour un capitaine de frégate 10 fr. et pour un lieutenant 6 fr. Les membres tiennent séance publique tous les trois mois : les réclamations lues par le secrétaire, doivent être d’abord vérifiées par deux membres. – La somme de secours généralement proposée est de 100 à 500 fr. ; elle est mise aux voix par le président, et adoptée ou rejetée par la majorité. Plymouth naval annuitant society ou barque de prévoyance. – Etabli il y a 15 ans au port de Plymouth, et dont le capital monte déjà à 72,000 liv. sterl. ou 1,780,000 fr. Cette banque est soutenue par un grand nombre de familles d’officiers de marine. Naval Médicand. – Etabli il y a 30 ans, par les officiers de santé de la marine royale, et spécialement voué au soulagement de leurs familles. La pension des veuves de ces officiers étant très modique, les plus prévoyans se réunirent et obtinrent du roi un ordre en conseil, pour qu’à l’avenir tout officier de santé, marié ou non marié, en entrant dans la marine royale, fut obligé de contribuer d’une somme fixe par mois, pour le soulagement général des veuves de ses confrères. Tel est l’état prospère de cette association fraternelle, que chaque veuve, au décès de son mari, reçoit une pension de 40 livres sterling ou 960 f. par an, outre celle du gouvernement. (Journal de la Marine1.) Moyen de reconnaître l’huile d’olive mélangée. Lorsqu’on agite une bouteille à moitié pleine, qui contient de l’huile d’olives pure, il se forme par l’agitation, des globules en forme de chapelet autour de la bouteille, mais ces globules disparaissent en se rompant très-promptement. Si l’on agite de la même manière un vase contenant de l’huile blanche, il se forme un chapelet, en tout semblable à celui formé par l’huile d’olive ; mais à cette différence près, que les bulles qui le composent ont une persistance d’une très grande durée. Enfin, si l’huile à essayer est mélangée, le chapelet formé a d’autant plus ou d’autant moins de persistance, qu’il entre plus ou moins de mélange d’huile étrangère dans celle d’olive. (Connaissances utiles.)

ERRATUM. Dans le dernier numéro, paragraphe du conseil des prud’hommes, seconde ligne, au lieu de : qui sert un maître, lisez : qui se met maître.

ANNONCES.
On désire une ouvrière en soie qui sache travailler sur le métier, pour apprendre le pliage par fil ; elle sera de suite à ses pièces ; seulement on passera un compromis pour la durée du temps.
S’adresser au bureau.

Notes
(M. Arlès Dufour , négociant-commissionnaire...)
Cet article fait ici référence au volume, Un mot sur les fabriques étrangères de soieries, à propos de l'exposition de leurs produits faite par la Chambre de commerce de Lyon, publié à l’imprimerie de Léon Boitel par Barthélémy Arlès-Dufour en 1834.
Notes
(VARIÉTÉS.)
Mention ici du Journal de la marine, des colonies, des ports et des voyages, publié à Paris depuis 1833.
|
|
|
|
|
|
|