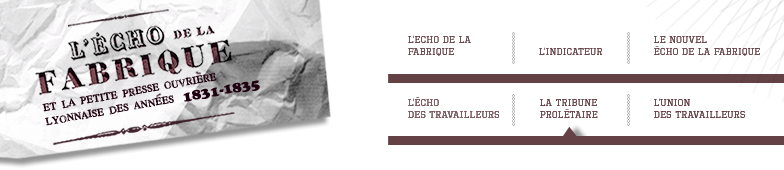|
|
29 mars 1835 - Numéro 13 |
|
|

|
|
| |


|
RÉPONSE A L’INDICATEUR En faveur de la libre défense. [1.1]Nous avons dit dans notre avant-dernier N° que dans toutes les sections mandat d’exiger la libre défense avait été donné aux prud’hommes : un autre journal qui a malheureusement compris le journalisme comme représentation des individus au lieu des principes, l’Indicateur, a jugé à propos de s’élever contre notre assertion, et de nier ce fait. Que devons-nous en conclure et le public avec nous ? Que ce mandat contrarie l’Indicateur et quelques-uns de ceux dont il reçoit l’impulsion. En effet, nous ne pouvons nous résoudre à croire que ce soit pur esprit d’antagonisme de la part de notre confrère, et qu’il adopte une thèse précisément parce que nous en formulons une autre. Il est vrai qu’il a déjà montré cet esprit étroit à l’égard du mot fabricant que nous appliquons (avec raison grammaticale et logique) aux chefs d’atelier, et qu’il a répudié pour cela, préférant en affubler les négocians qui ne fabriquent rien ; ce qui introduit dans le monde ouvrier un langage hétérogène et une grande confusion pour ceux qui lisent les deux journaux. Quoi qu’il en soit, et quelque motif que l’Indicateur ait pour agir hostilement contre la libre défense, nous n’oublierons pas qu’elle est un besoin de la fabrique ; et comme nous l’avons toujours soutenue, sinon avec succès du moins avec zèle, nous la soutiendrons encore contre l’Indicateur et ses adhérens. D’abord, établissons bien le point en litige : nous n’avons pas dit, et l’Indicateur est forcé de le reconnaître, que ce mandat avait été inscrit dans les procès-verbaux des élections ; nous avons dit seulement, qu’il avait été exigé des prud’hommes, en d’autres termes, qu’il avait été la condition sine qua non de l’élection des prud’hommes, c’est-à-dire, que le candidat qui l’aurait refusé, n’aurait pas obtenu les suffrages des électeurs. Nous maintenons notre dire. Quel a été le vœu unanime, ou au moins de l’immense majorité des électeurs, n’est-ce pas la libre défense ? Qu’on réponde oui ou non : la question est toute là. Et notamment M. Dufour, l’un des rédacteurs de l’Indicateur, niera-t-il que dans ses courses préliminaires près des chefs d’atelier de sa section, il les a entretenus de son désir d’obtenir la libre défense. Faut-il d’autre preuve du mandat ? et comment aurait-on pu lui l’imposer plus authentiquement ? s’est-il trouvé dans la salle lorsqu’il s’est agi de le faire expliquer à ce sujet ? il s’en est excusé dans une espèce de proclamation, en regrettant beaucoup d’avoir été forcéi de quitter la salle avant le dépouillement du scrutin ; il aurait évité des doutes sur son compte, il finit par déclarer qu’il adhère aux vœux, etc. Eh bien ! ce que M. Dufour appelle des vœux, nous l’appelons un mandat, et c’est là, ce nous semble, le mot propre. Les ouvriers adressent leurs vœux à la divinité, [1.2]ils donnent un mandat à leurs prud’hommes. M . Dufour se croient-ils donc d’une telle nature que ses camarades en soient réduits à lui adresser leurs vœux ! Dans une autre section, si l’on a renoncé à demander la signature du prud’homme élu ; n’est-ce pas sur sa déclaration expresse qu’il était partisan de la libre défense et d’après ses antécédents honorables ? Sans doute, il serait plus commode de n’avoir pas aujourd’hui de mandat à remplir ; il n’est pas étonnant qu’on le préfère, mais nier un mandat reçu, sous prétexte, qu’il n’a pas été écrit, est une action dont nous devons laisser aux lecteurs la juste appréciation. Eh bien ! M. Falconnet ne le nie pas, il a reçu le mandat d’exiger la libre défense. Et si donc, un prud’homme, autre que M. Dufour, ne croit pas ou ne veut pas avoir reçu un mandat, qu’il se nomme, et nous accueillerons son désaveu, et ses commettants en prendront note. N’est-ce pas une véritable absurdité de vouloir qu’une seule section (au dire de l’Indicateur) ait donné à son prud’homme le mandat d’exiger la libre défense, c’est-à-dire, de l’exiger seul. Quelle amère dérision ? si ce prud’homme n’est pas soutenu par ses collègues, pourra-t-il jamais l’obtenir ? non ; comme nous l’avons dit dans notre dernier numéro, ce n’est que par la réunion et par les efforts communs de la presse et des prud’hommes, que la libre défense palladium de tous les droits, obstacle invincible au rétablissement du huis clos, acheminement pacifique à la jurisprudence fixe, pourra être obtenue. Mais, comment l’espérer, si de prime abord, la presse se divise, si les prud’hommes veulent marcher sous des étendards opposés. Pourquoi donc l’Indicateur a-t-il élevé une voix discordante ? a-t-il craint de donner aux prud’hommes, par l’imposition d’un mandat, une force morale trop grande ? par l’unanimité de la presse populaire un appui trop redoutable ? En vérité, quel vertige l’a saisi ; il espère que la libre défense sera admise au conseil. Oh ! que son langage est froid. Cependant il sait se passionner pour des choses bien plus minimes, il voit en perspective et dans son style emphatique et niais, prophétise l’érection d’une colonne en l’honneur des fondateurs d’une boutique d’épiceries… Et pour le triomphe de la libre défense il se contente d’espérer. Il fait plus, il rompt l’harmonie qui, sur cette question vitale, existe dans la classe ouvrière ; et les prud’hommes que nous nous plaisions à représenter investis d’un mandat, obligés de demander et d’obtenir, il les représente comme chargés simplement d’exprimer des vœux, que savons-nous ? peut-être quelques doléances ; et comme à d’aussi faibles démarches le succès n’est pas dû, ces magistrats populaires endormiront leur conscience jusqu’au jour du réveil, qu’amène toujours une nouvelle élection, et alors ils en seront quittes pour dire : Nous pensons comme vous, nous avons fait tout ce que nous pouvions, etc. l’Indicateur a fait là plus qu’un mauvais article, il a commis une mauvaise action. La Tribune Prolétaire n’entend pas ainsi la défense des droits que dans son humble sphère elle a mission de protéger. Impossible, n’est pas français. Prud’hommes, [2.1]vous devez obtenir, et vous obtiendrez si vous voulezii. Vous obtiendrez, parce que ce que vous demandez est juste, est naturel ; le tribunal est sorti du droit commun, il doit y rentrer. Nous faisons plus que l’espérer, nous en sommes certains, pourvu que tous les prud’hommes chefs d’atelier le veulent, et si au lieu d’établir une polémique insignifiante, hostile aux travailleurs, l’Indicateur consent au moins pour cette question à marcher de concert avec nous. Lorsqu’il en sera temps nous indiquerons aux prud’hommes la marche à suivre. Que leur amour-propre ne s’en offense pas. La presse qui régente les pouvoirs de l’état ; la presse qui porte son investigation sur les questions les plus élevées, les plus ardues, et qui les juge en dernier ressort ; la presse peut bien prétendre donner d’utiles conseils à des magistrats populaires, et ceux-ci auraient mauvaises grâce, disons plus, bien peu de patriotisme à afficher pour elle un superbe dédain, à lui contester une prérogative qu’elle ne saurait jamais exercer que dans l’intérêt général, car elle est soumise elle-même aux arrêts de l’opinion publique.
i. M. Dufour ne dit pas pourquoi, et nous sommes trop honnêtes pour le lui demander. Il fallait que ce motif fût bien impérieux pour le forcer à manquer ainsi d’égards à ses collègues. ii. Un exemple peut le prouver. Les prud’hommes fabricans se rendaient chez les négocians pour régler les affaires renvoyées en conciliations, nous élevâmes la voix contre cet abus. Les prud. fab. avaient intérêt, ils exigèrent et tout fut dit. L’abus cessa.

Affaire PERRICHON c. DUCHÊNE. Nous avons annoncé dans le n. 8 du journal que le tribunal de commerce dans son audience du 9 février dernier avait confirmé le jugement rendu le 6 novembre précédent par le conseil des Prud’hommes, au profit de Duchêne, apprenti, contre Perrichon son maître. Voici le texte de ce jugement. « Considérant que le conseil des Prud’hommes est demeuré juste appréciateur de l’indemnité réclamée par le sieur Perrichon, à raison de la non-exécution des conventions verbales passées entre lui et Duchêne puisqu’il n’a rendu son jugement qu’après avoir délégué un de ses membres pour prendre les renseignements nécessaires et connaître les motifs de la non-exécution. « Considérant d’un autre côté que l’apprenti n’étant demeuré dans l’atelier du maître que pendant trois mois, l’indemnité accordée par le jugement du conseil des Prud’hommes est suffisante pour désintéresser le sieur Perrichon. « Par ces motifs le tribunal ordonne l’exécution du jugement du 6 novembre etc., compense les dépens etc. » Nous avons beaucoup de respect pour les tribunaux mais nous en avons encore plus pour la loi et plus encore pour la logique qui est à nos yeux la première des lois. D’ailleurs ce n’est pas manquer de respect aux juges que de les rappeler à la stricte observance de la loi, et de soumettre leurs jugements à l’analyse de la logique. Nous nous permettrons donc de dire que dans cette cause le tribunal de commerce a violé l’une et l’autre. Il ne suffit pas de le dire il faut le prouver, c’est ce que nous allons essayer : Nous disons que la loi a été violée et en effet voici ce que porte l’article 1152 du Code civil. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Ce texte est, comme on le voit clair et précis ; or la convention entre Perrichon et Duchêne portait un dédit de trois cents francs c’était donc cette somme qu’il fallait allouer ni plus ni moins pour se conformer à la loi. Quels ont donc été les motifs du conseil des Prud’hommes et ensuite du tribunal de commerce pour la diminuer au profit de l’apprenti ? Le conseil des Prud’hommes n’en a point donné, nous devons le croire, car autrement le tribunal de commerce se serait servi de la formule consacrée adoptant les motifs des premiers juges. Nous ne pouvons donc soumettre à la critique que les considérans du tribunal de commerce, et c’est ici qu’il faut prouver qu’après avoir violé la loi, il a contrevenu aux règles de la logique. Nous ferons une observation préliminaire. Ce n’est pas sans raison que le législateur a exigé que les juges fussent obligés de motiver leurs sentences, et il n’a pas sans doute pensé qu’on éluderait cette prescription par un [2.2]certain arrangement de mots qui paraissent des motifs et qui n’en sont pas, comme dans l’espèce. Que dit le premier considérant ? que le conseil des prud’hommes est demeuré juste appréciateur de l’indemnité réclamée, puisqu’il n’a prononcé qu’après avoir ouï le prud’homme délégué. Nous concevons bien qu’un tribunal s’en rapporte à l’un de ses membres, mais alors il doit traduire dans son dispositif les motifs qui ont déterminé l’opinion du juge rapporteur ; il le doit puisqu’il se les rend propres ; ainsi dans l’espèce il ne suffit pas de faire entendre que le prud’homme rapporteur (M. Charnier) a été d’avis qu’une somme moindre que celle réclamée fût allouée au chef d’atelier, il faut encore dire pourquoi ce prud’homme a été de cet avis, car il fallait un motif pour écarter l’article 1152 qui était précis, formel, par exemple ; si le chef d’atelier avait des torts, nul doute que l’apprenti avait un motif légitime de rompre la convention, et le tribunal statuant sur les torts réciproques des parties pouvait alors modérer l’indemnité, mais encore une fois, il fallait un motif, ou la loi était violée, il fallait énoncer ce motif, ou la logique était violée. Nous ne voyons pas d’autre raisonnement plausible. Quant au second considérant : le tribunal dit que la somme de 150 fr. est suffisante pour désintéresser le chef d’atelier. Mais qu’importe au tribunal, qu’elle soit ou non suffisante, était-ce là la question à juger. Était-il appelé à concilier les parties, à rédiger leurs conventions ? non, il était chargé de les juger et de faire exécuter la convention qui les liait. Il devait donc appliquer l’article 1152 du Code civil ou dire pourquoi il ne l’appliquait pas, et c’est ce qu’il n’a pas fait. Et voyons jusqu’où peut aller la conséquence de cet oubli. Le public toujours plus porté à croire le mal que le bien, ne pourra-t-il pas supposer que le chef d’atelier avait des torts à se reprocher, et une fois le champ des conjectures ouvert, qui peut dire où s’arrêtera la méchanceté ? Les bruits calomnieux ont de l’écho ; un homme estimable peut voir sa réputation compromise et tout cela parce que contrairement à la loi un tribunal aura négligé de faire connaître les motifs de sa décision. En résumé, on n’échappera pas à ce dilemme : ou le chef d’atelier n’avait point de torts, et alors on a violé la loi en diminuant arbitrairement l’indemnité stipulée, ou ce chef d’atelier avait des torts, et on a violé la logique en ne les énonçant pas puisqu’ils servaient de motifs à la réduction de l’indemnité stipulée, et dans ce dernier cas on a encore violé la loi qui veut que les mots du jugement soient énoncés dans le dispositif. Nous savons bien que le tribunal a été préoccupé de l’idée qu’une somme de 300 fr. était une indemnité trop forte pour la résiliation d’une convention d’apprentissage qui n’avait duré que trois mois. Cette objection ne prouve qu’une chose, c’est que le tribunal a eu tort de se préoccuper. Nous prouverons ailleurs que l’indemnité stipulée en cas de résiliation des conventions d’apprentissage n’est pas seulement la représentation du prix de la nourriture et du logement, mais le prix des soins et de l’instruction fournis par le maître à son élève. Le tribunal a encore été, peut-être préoccupé de l’idée que le conseil des prud’homme était compétent plus qu’aucun autre dans cette matière, et qu’il était convenable de s’en rapporter à lui. – Il y aurait eu dans ce cas courtoisie de sa part ; mais cette courtoisie n’est pas une excuse valable. Avant tout, la loi ; d’ailleurs, le tribunal devait examiner quels avaient été les motifs des premiers juges, et n’en trouvant pas, il devait juger lui-même en prenant la loi pour base, et d’après les faits de la cause. Espérons qu’une autre fois, soit le conseil des prud’hommes, soit le tribunal de commerce, si de pareilles contestations se présentent se souviendront que leur premier devoir est d’obéir à la loi, et qu’un jugement n’obtient cette sanction, qui a fait dire aux légistes : Res judicata pro veritate habetur (la chose jugée est tenue pour vérité) qu’à la charge d’être la reproduction exacte d’un texte légal, et de porter avec lui l’évidence, en sorte qu’il témoigne par [3.1]lui-même de la justice qui a présidé à sa naissance. Les motifs d’un jugement pour nous servir d’une comparaison qui rend notre pensée, sont les témoins que l’ouvrier terrassier laisse pour qu’on puisse cuber ses travaux.

CONSEIL DES PRUD’HOMMES.
Séance du 26 mars 1835. Président : M. Riboud vice-président ; Membres : MM. Chantre, Cochet, Dufour, Dumas, Jubié, Micoud, Perret, Putinier, Rodet, Roux, Troubat, Wuarin, Vérat. 26 causes sont appelées dont 8 sur citation. 5 sont arrachées ; 6 sont renvoyées à huitaine ; de ce nombre celles de Giraud Bedda contre Cherpo, et de Pellerin contre Troubat-Vernasi. 1 à quinzaine (Marietton c. Robert, Robert et Clemançon), pendant lequel temps MM. Berthaud, Cochet, Chantre et Jarnieux feront enquête sur le point en litige. 4 causes sont jugées par défaut, entr’autres Muguet c. Morier ; Audemar c. Lachapelle, etc. Les autres ont été jugées contradictoirement, de ce nombre sont les suivantes : BONNAFAI c. FALCOT. La question à juger était celle-ci : Y a-t-il lieu à résilier sans indemnité une convention d’apprentissage faite avec un chef d’atelier, qui est en même temps commis-négociant, lorsqu’on avait eu connaissance de ce fait à l’époque de la passation de l’acte ? – Non. Le conseil considérant que Bonnafai avait connaissance que Falcot était commis à l’époque où il a placé chez lui son fils en apprentissage, l’a condamné à payer 100 fr. d’indemnité, indépendamment des 4150 fr. payés à compte de l’apprentissage. CARRIER c. GAUTIER. La question à juger était celle-ci : Lorsque des parties, quoique étrangères à la fabrique, ont déclaré dans les conventions d’apprentissage qu’en cas de difficulté, elles seraient jugées par le conseil des prud’hommes, ce dernier est-il compétent ? – Oui. Le conseil a retenu la causeii et a renvoyé par une seconde décision, à huitaine, pour s’enquérir des faits reprochés à l’apprenti par son maître, qui consistent dans la fréquence de ses absences de l’atelier. CHAUVET c. GOLDER. La question à juger était celle-ci : L’ouvrier qui loue son travail pour plusieurs années, à tant par jour, doit-il être condamné à des dommages intérêts s’il n’exécute pas cette convention ? – Oui. Golder s’était engagé chez Chauvet pour deux ans, à raison de 4 fr. par jour. Il avait absenté deux cents journées, et le 3 janvier 1834 il avait été condamné par le conseil à remplacer le temps perdu ; n’ayant pas satisfait à ce jugement, il a été condamné a 200 fr. de dommages-intérêts. GARNIER c. ORAN. La question à juger était celle-ci : Le livret du compagnon, resté entre les mains du chef d’atelier, sert-il de preuve à ce dernier pour le montant de sa créance, qui y est inscrite, sans qu’il soit besoin de la prouver autrement, surtout s’il est constant que le compagnon, ayant été travailler dans un autre atelier, a déjà subi la retenue d’un huitième ? – Oui. Garnier a été condamné à payer à Oran la somme de [3.2]40 fr. 25 c. pour solde, déduction faite de 8 fr., reçus à compte en 1826, par suite de la retenue d’un huitième, faite par le chef d’atelier qui l’occupait. GAUCHON c. BONNAND. Gauchon ayant reçu de Bonnand une pièce (parapluie façonné) très mauvaise, et pour laquelle il venait de monter le métier, consentit à la fabriquer moyennant une indemnité de 20 fr., que Bonnand inscrivit volontairement sur le livre. La pièce fabriquée, Bonnand voulait mettre le métier à bas, ou que Gauchon annula cette indemnité de 20 f. ; et par compensation, il lui allouait 10 c. par aune sur les 57 de la mauvaise pièce fabriquée. Gauchon s’y était refusé et avait fait appeler Bonnand en payement de 30 fr., pour frais de montage. Le conseil a ordonné que l’article d’indemnité de 20 fr. subsisterait, et que Bonnand continuerait d’occuper le métier ou payerait une indemnité qui serait réglée par le conseil. Bonnand a accepté de continuer de donner de l’ouvrage.iii REYNAUD c. ARNAUD. Mr Vérat a été délégué pour régler le prix de la façon demandée, par Reynaud, fabricant, à Arnaud, négociant. VALET c. MIÈGE. Miège a été condamné à payer à Valet la somme de 7 fr. 50 c. pour indemnité, attendu qu’il ne lui avait pas donné la huitaine d’usage.
i. Cette cause était la cinquième sur le rôle, mais le président l’a renvoyée d’office à la fin de l’audience. Appelée alors, le conseil ne s’est plus trouvé en nombre, force a été de la renvoyer à huitaine. Nous concevons tous les égards qu’entre collègues on se doit, et combien il peut en coûter à un magistrat de descendre de son siège pour venir à la barre plaider comme un simple particulier ; mais il n’est pas juste qu’un ouvrier perde son temps pour satisfaire à des convenances qui lui sont étrangères, encore moins à la commodité de sa partie adverse ; d’ailleurs, M. le président pouvait réfléchir que l’amour-propre de M. Troubat n’avait nullement à en souffrir : ce n’est pas la première fois qu’il échange son rôle de juge contre celui de plaideur. ii. Nous voyons avec plaisir que petit à petit le conseil des prud’hommes commence à reconnaître les règles judiciaires. Il a statué séparément comme il le devait sur sa compétence avant d’aborder la question du fond. iii. Le conseil a donné avec raison à Bonnand l’alternative de faire ou de ne pas faire, et en cela il s’est conformé à la loi aussi ; Bonnand comprenant sa position, n’a pas hésité. Si le conseil en avait agi ainsi dans l’affaire Chapeau c. Grillet et Trotton (v. Echo des Travailleurs n os 24, 25, 26, 29 et 30), le déplorable procès, qui a eu lieu, n’aurait jamais exister.

Les ouvriers commencent à apprécier le charlatanisme de la boutique d’épiceries de l’Indicateur. Nous recevons à ce sujet, et pour répondre en même temps à quelques attaques dirigées par M. Derrion contre la maison centrale de la fabrique, une lettre de M. gauthier que le défaut d’espace nous force de renvoyer au numéro prochain.

tableau
des élections du conseil des prud’hommes.
| |
Prud'hommes-négocians. |
|
| |
Inscrits. |
Votans. |
Manquans. |
|
| Sect. unique. |
524, |
74, |
450. |
La moitié plus 188. |
| |
Prud’hommes-fabricans. |
|
| 1re Section. |
324, |
151, |
173. |
La moitié plus 11. |
| 2e Section. |
261, |
137, |
124. |
La ½ moins 6. |
| 3e Section. |
304, |
142, |
162. |
La moitié plus 10. |
| 4e Section. |
188, |
101, |
87. |
La ½ moins 7. |
| 5e Section. |
219, |
108, |
111. |
La moitié plus 2. |
| 6e Section. |
329, |
145, |
184. |
La moitié plus 20. |
| 7e Section. |
300, |
113, |
187. |
La moitié plus 37. |
| 8e Section. |
177, |
81, |
96. |
La moitié plus 8. |
Il y a 2,102 électeurs fabricans inscrits et 978 votans seulement. 1,124 ne se sont pas rendus à ces élections et ne peuvent pas dire qu’ils ont fait leur devoir.

AU RÉDACTEUR.
Monsieur, Je viens de lire dans votre dernier N° un article, Extrait de la gazette des tribunaux, contre la perception que font les greffiers des justices de paix d’une somme de 25 c. pour la délivrance des billets d’invitation. Vous ajoutez que cette somme est également exigée à Lyon, et vous vous élevez avec votre confrère de Paris contre cet abus prétendu. Je ne suis pas de votre avis ; je pense seulement que le prix est trop cher, et que c’est mal à propos qu’il a été porté de 15 à 25 c. Personne n’est tenu de faire la guerre à ses dépens, et il serait fâcheux que par la suppression d’une taxe minime, on en vint, dans les tribunaux de paix, à négliger l’invitation préalable à la citation qui est un acte judiciaire dont l’emploi aigrit toujours plus ou moins les parties. Je proposerais que ce droit fût rétabli à 15 c. ; mais je voudrais d’abord que le greffier se chargeât de faire [4.1]parvenir les invitations aux personnes appelées, et ensuite que ce coût fut compris dans la liquidation des dépens. A l’égard de la somme de 5 fr. que perçoivent, selon vous, les greffiers de justice de paix pour l’enregistrement des minutes des jugemens dont on ne demande pas expédition de suite : si cela est vrai, et je n’en doute pas, puisque vous dites en avoir la preuve, c’est une véritable concussion à laquelle les justiciables doivent se refuser, et il suffira sans doute que vous ayez appelé l’attention publique, et notamment celle de ces messieurs les juges de paix sur cet abus pour qu’il disparaisse. C’est par cette investigation journalière et non par de vaines déclamations ou par des théories plus vaines encore que la presse populaire, est utile, et je vous félicite d’en donner l’exemple. J’ai l’honneur, etc. C...., avocat.

COUR D’ASSISES DU RHÔNE. L’affaire capitale de la session qui vient d’avoir lieu, est celle de Humbert de Vaise, prévenu de plusieurs tentatives d’empoisonnement. Notre cadre nous empêche de narrer les nombreux détails de l’accusation. Nous raconterons en peu de mots les faits principaux : Marié en 1822 avec une demoiselle Deleschamps, M. Humbert eut peu de temps après à plaider avec sa femme, en séparation de corps, suite de ses mauvais traitemens et de ses menaces atroces. Il paraîtrait qu’une haine violente fut la conséquence de ce procès, et qu’il enveloppa dans sa haine Me Chazourne, avocat de sa femme, son beau-père, sa belle-mère et son beau-frère. Il aurait, dit l’accusation, essayé de les empoisonner, en leur envoyant des boîtes de bonbons, de fruits confits, etc. – Une semblable tentative avait eu lieu contre M. Yvrad, avoué, et ce dernier l’attribuait à une rancune de Humbert, qu’il avait poursuivi. – Pendant toutes les dépositions à charge l’accusé a gardé une impassibilité profonde, mais, rentré dans sa prison, il s’est suicidé dans la nuit de samedi à dimanche dernier, pendant qu’on transférait les détenus politiques de Roanne à Perrache. – On l’a trouvé pendu dimanche matin. – pean, accusé de banqueroute frauduleuse, a été condamné à deux ans de réclusion seulement, ayant été acquitté sur les faits principaux. – laurenson et vanderhaize, accusés d’abus de confiance, par un commis, au préjudice de son maître, et de complicité, ont été acquittés. – Amédée roussillac, ex-gérant du Précurseur, qui a cessé de paraître, a été condamné à 6 mois de prison et 2,000 fr. d’amende. M. boitel, imprimeur, a été acquitté. – La cause a été disjointe en ce qui concerne M. buquet, auteur de l’article incriminé, et renvoyée aux prochaines assises.

QUINZE ANS ET VINGT-CINQ ANS. Elle était fraîche et svelte comme on l’est à quinze ans, lorsque l’on jouît d’une organisation privilégiée, et que le moral n’a pas encore dégradé le physique ; car il ne faut pas s’y tromper, les passions usent plus vite que les années. Elle avait encore toute la candeur de ces illusions de jeune fille, dont chaque frottement du monde enlève un brin, et qui finissent par tomber une à une devant, l’expérience de la vie sociale, comme les perles d’un bandeau brisé dans une nuit de bal. Elle entrait en aveugle dans la civilisation, telle que nous l’ont faite et les préjugés et les intérêts, ignorante de l’avenir, heureuse du passé et confiante dans le présent, comme un matelot novice qui s’embarque par un beau temps et qui ne sait pas prévoir les tempêtes. Alors à ses yeux tout était bonheur, espérance : c’est toujours ainsi pour celle qui n’a pas vécu long-temps. Elle avait de l’amour ; car l’amour est la première illusion des femmes. Elle croyait à l’amitié, à la pudeur, à la bonne foi et à toutes les vertus de l’âge d’or… Heureuse jeune fille !! Elle croyait à l’amour parce qu’elle se sentait capable d’aimer ; A l’amitié, parce qu’elle l’éprouvait ; A la pudeur parce qu’elle ressemblait à la sensitive ; [4.2]A la bonne foi, parce que son cœur n’avait jamais été trahi. Elle croyait à la religion !… Elle méritait d’être heureuse, de trouver des âmes pour la comprendre et un appui pour la soutenir sur la route. C’eût été un crime de ternir d’un souffle la pureté de cette âme candide, vivant en elle, cherchant à épancher au-dehors, pour le bonheur des autres, tous les trésors d’amour et de bonté renfermés dans son sein virginal. Ce crime cependant a été commis ! Mais qui pourrait-on en accuser ?… Je l’ai revue dix années plus tard : elle était belle encore : mais de cette beauté qui électrise comme du champagne, et qui monte à la tête sans parler au cœur. Son front était déjà sillonné d’un pli, de ce pli des pensées fortes, qui révèle, sur une tête jeune encore, le passage des passions. Son œil moqueur avait gagné en vivacité ce qu’il avait perdu en tendresse : c’était le regard étincelant d’une Erigone au lieu du regard lumineux d’un ange. La civilisation et le monde avaient passé par là ! Elle ne croyait plus à l’amour, parce qu’elle avait aimé et que… horreur ! Elle ne croyait plus à l’amitié, parce qu’elle avait été trahie par sa meilleure amie, une amie d’enfance : cela arrive à beaucoup de femmes. Elle ne croyait plus à la pudeur, car elle avait vu ses compagnes aux prises avec la séduction. Elle ne croyait plus à la bonne foi, parce qu’elle avait eu de vives discussions d’intérêt, soulevées par l’avarice d’un parent qui avait juré de lui servir de père. Elle avait vécu assez en dix ans pour apprécier le monde, ce qu’il vaut, et son cœur se trouvait à la fois vide et désillusionné. Elle ne croyait même plus à son culte religieux, car… et en doutant du ministre, elle avait fini par douter de la divinité. Elle était devenue sceptique, elle mourra probablement athée ! Et voilà comme le monde a fait ma jolie fille de quinze ans ! Je la plains, cette jeune fille, de n’être pas morte à quinze ans : il est si doux de mourir avec confiance ! Elle a vingt-cinq ans aujourd’hui… Pauvre femme !…

GYMNASE. vendredi prochain, au bénéfice de Mme HERLISKA, les premières représentations de la Femme qu’on n’aime plus, vaudeville en un acte ; le Capitaine Roland, ou est-ce un garçon, est-ce une fille, idem ; Georgette, idem.

Le mot du dernier logogriphe est émoi.

CANCANS.
L’Indicateur est vraiment un journal comme il n’y en a pas. Non content de fonder une boutique d’épiceries, il crée des grands hommes : témoin Alexandre de Lacédémone qui n’a jamais existé que dans ses colonnes. Il paraît qu’un professeur d’histoire serait autant nécessaire à l’Indicateur qu’un professeur de grammaire.

(36-1) Un Métier de mouchoir ¾ façonnée et un de gilet satin à prendre. S’adresser au bureau. (35-2) On demande une fille qui sache dévider ; on lui donnera un gage. S’adresser chez M. martinon, place de la Croix-Rousse, n. 17, au 2e. (34-5) A VENDRE un métier 6/4 au quart ; mécanique en 1,500 montée à neuf. S’adresser au Bureau.

|
|
|
|
|
|
|