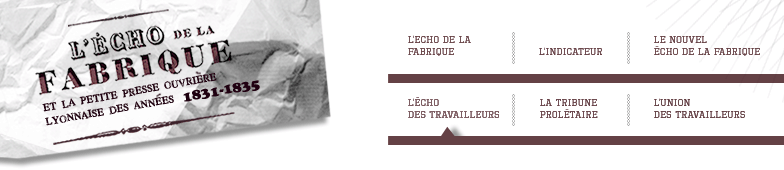|
|
11 décembre 1833 - Numéro 12 |
|
|

|
|
Me Parquin.
quelques mots sur l’ordre des avocats. [1.1]Les corporations, quelques noms qu’elles portent, sont des institutions surannées, et il en est de l’ordre des avocats et de son bâtonnier, comme des libertés de l’Eglise gallicane. Toute l’érudition de M. Dupin ne parviendra pas à les rajeunir.
le nation., 7 déc. 1833, n. 341. Ces hommes que l’on voit se promener dans les rues, affublés d’une longue robe noire, imitant la toge romaine, coiffés d’un coiffés d’un bonnet grotesque, ce sont des avocats. Il n’y a :plus qu’eux qui partagent avec les prêtres et les ignorantins le droit de sortir en public dans un costume différent des autres citoyens. Beaucoup de ces messieurs se disent républicains, presque tous libéraux. Les priviléges, les monopoles leur font horreur ; ils sont certainement de bonne foi dans leur haine du monopole ; nous sommes convaincus qu’ils n’en exceptent qu’un seul, celui dont ils jouissent : ils feraient bon marché de tous les autres, même de celui des avoués. Aussi, ils forment un ordre, lequel a un conseil de discipline dont le président s’appelle BATONNIER. Les droits de citoyen ne suffisent pas aux avocats ; ils ont des prérogatives, des priviléges, ni plus ni moins que l’église Gallicane avait ses libertés, que Me Dupin rappela sans rire l’an de grace 1828 ou 1829, peu importe. Ce préambule était nécessaire pour l’intelligence de ce qu’on va lire, et pour apprécier le grave débat surgi entre Me Parquin et M. Seguier ; car, grand est l’émoi qui règne en ce moment dans le sein du barreau de Paris. Nos lecteurs savent ou ne savent pas que l’ordre des avocats de cette capitale a pour bâtonnier actuel, Me Parquin. Or, cet avocat a été cité à la requête d’un ancien confrère, aujourd’hui procureur-général, monsieur Persil, pour le 5 de ce mois, devant la cour royale de Paris, à l’effet de voir prononcer contre lui telle peine de discipline qu’elle croirait convenable, à raison des expressions offensantes et blessant la dignité des magistrats, contenues dans un discours prononcé par lui le 28 novembre dernier, à la conférence des avocats. Ne vous arrêtez pas, de grâce, lecteurs, sur cette méthode de déférer aux parties elles-mêmes, le jugement des griefs dont elles ont à se plaindre. Quelques détails sur l’origine de cette affaire qui commet la magistrature et le barreau, trouvent ici leur place, et l’on nous en saura gré. Le 15 avril 1833, Me Perrin, avoué, demanda au nom de Me Marie, avocat, la remise d’une cause ; il donna [1.2]pour motif que cet avocat était appelé dans le même moment à plaider devant la cour d’assises. M. Seguier, premier président, refusa en disant : C’est pour la cour d’assises que l’avocat nous a quittés ; votre client vaut bien Cabeti et nous valons bien la cour d’assises… Il est déplorable que les avocats s’occupent d’affaires politiques ; ils feraient mieux de se consacrer aux causes civiles, c’est leur affaire. Ce langage était on ne peut plus inconvenant et inconstitutionnel. Les avocats comptent avec raison au nombre de leurs premiers devoirs la défense des accusés. Sur l’insistance de Me Perrin, M. Seguier accorda la remise demandée, en disant : « C’est pour vous, pour vous seul, car nous savons tous votre manière franche et loyale de penser et votre attachement à l’ordre public. » Qu’est-ce que l’opinion politique de Me Perrin et son attachement à l’ordre public pouvaient avoir de commun avec l’affaire de son client ? De telles paroles devaient-elles être prononcées dans le sanctuaire de la justice ! Me Marie dénonça ce fait scandaleux au conseil de discipline de son ordre, qui prit le 18 avril un arrêté par lequel il déclara protester contre la profession de principes attentatoires aux droits du barreauii et contre les expressions injurieuses pour Me Marie que s’était permises M. Seguier, et copie de cet arrêté lui fut adressée. On n’osa pas alors se plaindre, il n’y eut pas de procès. Le 28 novembre dernier, dans la conférence ordinaire des avocats, Me Parquin, réélu bâtonnier, prononça un discours dans lequel se trouve le passage suivant : Me Marie avait reçu d’un magistrat d’un rang élevé une grave insulte ; il la dénonça au conseil de l’ordre, et sur-le-champ il en obtint la satisfaction désirée. Une décision mémorable dont la place est déja retenue dans les annales du barreau français, alla jusque sur son siége saisir l’offenseur et lui infliger un blâme sévère, et cette décision, ce blâme ont été acceptés en silence, etc. M. Persil a traduit, comme nous l’avons dit ci-dessus, Me Parquin devant la cour, pour être jugé disciplinairement. Le conseil des avocats s’est assemblé de suite, et a décidé que la question de l’incompétence de la cour serait plaidée ; il a délégué Mes Mauguin, Hennequin et Ph. Dupin, pour assister leur confrère. Me Parquin s’est en effet présenté à l’audience de la cour, jeudi dernier. L’incompétence a été proposée et discutée par Me Mauguin. La cour, jugeant à huis-clos, s’est déclarée compétente. Me Parquin s’est alors retiré, déclarant faire défaut sur le fond ; et par un second arrêt, la cour lui a enjoint d’être plus circonspect à l’avenir. [2.1]Rapprochez cette bénigne censure (laissant de côté la question de compétence) des condamnations acerbes prononcées contre le National et le Charivari, accusés d’un délit à peu près pareil et même moins grave. O esprit de corps et de privilége ! Les barreaux de Rouen, de Versailles, etc., ont envoyé des adhésions à Me Parquin. Ce dernier a dû se pourvoir en cassation. Me Parquin ne s’est pas immédiatement pourvu en cassation. Aussitôt l’arrêt de compétence rendu, il a été dîner chez M. Debelleyme, président au tribunal civil. A ce dîner sont arrivés successivement MM. le garde des sceaux Barthe, le premier président Seguier, le procureur général Persil, et enfin M. Dupin, procureur général à la cour de cassation, et autres notabilités. M. Dupin, qui, dit-on, voulait à tout prix avoir sa revanche de Saint-Acheul, a, en quelque sorte, jeté M. Parquin dans les bras de M. Seguier… Ils se sont embrassés,… comme on fait à la cour. Tout a été dit. Les journaux ministériels ont inséré de suite une note triomphale, et l’arrêt devait, au dire de M. Persil, ne pas être notifié. Me Parquin se tenait donc pour satisfait ; mais le conseil de discipline ne l’a pas voulu, et cet avocat, s’exécutant de bonne grâce, s’est pourvu en cassation : mieux vaut tard que jamais. Voila l’état actuel du procès. Nous tiendrons les lecteurs au courant de cette affaire qu’on aurait voulu, il paraît, étouffer après l’avoir imprudemment suscitée. Nous n’avons pas besoin de dire que nos vœux sont pour le triomphe des droits des avocats, lors même que, avec tous les organes indépendans de la presse, nous nous prononçons contre le monopole de la défense qu’ils exercent ; mais nous avons l’espérance que tôt ou tard ils sentiront combien est ridicule le rôle d’un apôtre de l’égalité savourant lui-même les douceurs du privilége, à peu près comme Sénèque, écrivant sur une table d’or, au dire de l’histoire, un traité fort pathétique sur le mépris des richesses. Que de Sénèques dans le monde !… Cette contestation a rappelé au public que les avocats qui plaident si souvent contre les monopoles et les priviléges, forment eux-mêmes une classe de privilégiés, et que ces hommes libres par excellence sont courbés sous le joug despotique d’un conseil de discipline. Aussi le Messager des Chambres leur adresse-t-il ces paroles auxquelles nous nous associons autant qu’il est en nous : « Mettez, mettez de côté la cause du privilége ; soyez des citoyens comme nous, sans robe et sans bonnet carré ; défendez du même coup, puisque les questions se confondent, la liberté du travail en vos personnes, et en votre nom les garanties politiques des accusés. De grace, redevenez monsieur un tel, au lieu de maître Parquin ou maître Seguier, si vous voulez agrandir votre querelle et y entraîner la société ; car persuadez-vous qu’aujourd’hui, hormis les privilégiés, personne ne s’intéresse chaudement à la conservation du privilége. Il est bien, quand on occupe pour les accusés, de les défendre ; mais la défense serait toujours plus libre et plus complète, si le défenseur, affranchi de tout réglement disciplinaire, n’avait de compte à rendre qu’à son client. » (Messager des Chambres, n°. 339, 5 déc. 1833.) Déja, et dans une occasion à peu près semblable, nous nous étions prononcés de la même manière ! Le barreau lyonnais, dit-on, nous en garde rancune. Est-ce que par hasard nous aurions eu le grand tort d’avoir trop tôt raison ? Lorsque MM. Chaney, Périer, Charrassin et Bacot furent menacés de destitution pour avoir signé une consultation en faveur du droit des citoyens de donner un banquet à Garnier-Pagès, contrairement à l’arrêté du préfet, nous dîmes alors à ces avocats comme aujourd’hui, et plus éloquemment que nous, le journaliste de Paris à Me Parquin : « Rendez encore un service à la société, déposez cette toge qui, loin de garantir votre indépendance, la compromet ; brisez cette chaîne du privilége, et venez comme citoyens prêter un ministère sacré (celui de la parole) à vos concitoyens… « Le privilége vous rendait esclaves, soyez libres en renonçant au privilége » (V. l’Echo de la Fabrique, 1833, n° 19, p. 151). Nos principes n’ont pas changé : d’autres que nous, on le voit, les adoptent et les propagent. Quant à nous qui n’attaquons pas tel ou tel monopole, [2.2]mais tous les priviléges, tous les monopoles, nous ne croirons à la haine du privilége, que lorsqu’un avocat considéré, influent, déclarera que pour lui il y renonce, et en signe de vérité, en déposera les insignes en présence de ses concitoyens.
i. M. Cabet, député. C’est de ce citoyen estimable que Me Seguier parle ainsi. ii. N’aurait-il pas eu aussitôt fait de dire : Contre les droits des citoyens ?

Le Messager des Chambres, en commentant le jugement du trib. de police correct. de Paris contre les ouvriers tailleurs, fait les réflexions suivantes, qui corroborent ce qui a été dit dans l’article du droit de coalition, inséré dans notre dernier numéro : « C’est donc la coalition des ouvriers qu’on a prétendu punir, la coalition pure et simple, dégagée de tous actes répréhensibles aux yeux de la morale ; c’est un délit tout légal, un crime de convention que l’on a voulu frapper ; trois ans de prison pour un délit fictif, pour un acte qui redeviendra innocent dès que le législateur aura supprimé l’art. 415 du code pénal. »

Réflexion du National. On punit les coalitions et tout le monde se coalise. Voici les juges coalisés contre les avocats, et les avocats contre les juges (1) ; voici les courtiers coalisés contre les agens de change, et les agens de change coalisés contre les courtiers (2). La destruction de tous les monopoles peut seule terminer cette guerre intestine qui déchire la société (3). Le National, n. 339, 4 déc, 1833. Notes du rédacteur. (1) Affaire de M. Parquin, bâtonnier de l’ordre des avocats. (2) Les courtiers en titre veulent empêcher les courtiers marrons de faire des marchés à terme. Notez que ces marchés sont interdits par la loi aux uns et aux autres. C’est la même chose à peu près que ce qui se passe au tribunal de commerce de Lyon. Il est défendu aux avoués de s’y présenter en cette qualité, et ils sont parvenus à obtenir d’y être admis seuls ; et pour qu’on n’ignore pas le mépris qu’ils font de la loi, ils y viennent affublés de la robe et du bonnet carré. (3) C’est aussi notre avis. Peu à peu l’on y viendra. Le Messager des chambres partage déja cette opinion. Voy. l’article ci-dessus, Me parquin.

Lyon, le 15 novembre 1833. Monsieur le rédacteur, Je vous dois bien des remercîmens pour la note bienveillante que vous avez ajoutée au compte-rendu que j’ai donné d’une assemblée d’échangistes ; mais je n’accepte vos éloges que comme un encouragement à mieux faire, et ils m’imposent de nombreux devoirs que je saurai remplir, sinon avec avantage, du moins avec courage et persévérance. Vous avez raison, M., lorsque vous dites que l’échange réalise les théories de M. Fourier ; nous en avons l’intime conviction, on doit arriver plus promptement par nos doctrines que par celles de M. Fourier à faire jouir le peuple de cette somme de bonheur et de richesse, qui est également le but que nous voulons atteindre, les Phalanstériens et nous. M. Fourier nous semble en effet tomber dans les erreurs qu’il a si fortement reprochées aux autres. Comme tous les autres économistes, il a touché du doigt la plaie de notre époque. Plus hardi que quelques-uns de ses confrères, il a même apposé l’appareil, mais il demeure aussi interdit devant son œuvre. Il faut aux Phalanstériens deux puissances ou moteurs pour arriver à leur but : la puissance de l’association et celle du numéraire. Nous sommes les premiers à reconnaître la supériorité de M. Fourier en harmonie sociétaire ; ce sont ses principes, ses vues d’association que nous mettons chaque jour en pratique. Nous avons vu comme lui misère, infortune et faiblesse dans l’isolement, richesse, bonheur et force dans l’association ; et nous trouverons en elle un levier assez puissant pour nous passer du numéraire. De l’aveu même des Phalanstériens, l’argent est le seul obstacle au complément de leurs travaux, à la mise en [3.1]pratique de leurs théories. Encore quelques écus, s’écrient-ils, et vous serez heureux ! Mais les gens de la finance sont également sourds à leurs doléances et à leurs flatteries ; la mise en exécution des doctrines phalanstériennes ne les séduit pas plus que la misère du peuple les émeut. Faute d’une pincée d’argent, devons-nous donc renoncer à cette prospérité, à cette harmonie si désirée ? Et dans ce siècle de progrès, les vertus de l’association doivent-elles pâlir devant les vices du numéraire ? la matière doit-elle s’effacer devant le signe ? devons-nous nous prosterner à toujours devant le veau d’or ? Telle n’est pas notre pensée, à nous, échangistes ; nous croyons que lorsqu’un obstacle quelconque s’oppose à l’émancipation intellectuelle ou au bonheur social, on doit briser l’obstacle et non pas chercher à l’amoindrir ; nous croyons enfin qu’il y aurait bien plus de mérite à se passer d’un argent qu’on ne peut avoir, que de le quêter sans cesse et presque sans succès. Il est facile de concevoir que dans les habitudes ordinaires de la vie on puisse difficilement se passer de numéraire, parce que les hommes sont isolés, et qu’il leur a fallu un signe de convention, commun à tous, pour parer à des besoins qui leur sont également communs (nous parlons des premiers besoins) : mais en association, et en association, qui a pour base le travail, qu’est-il besoin du signe monétaire ? Effacez donc ce signe qui vous gêne, et reproduisez la chose. Le travail et le produit du travail, voila les valeurs réelles : mettez ces valeurs en mouvement ou en circulation par un signe quelconque, que vous décorerez du nom qui vous conviendra. Qu’avons-nous fait autre chose en formant notre association et en émettant sur la place de Lyon 2000 bons d’échanges, représentant des travaux ou marchandises, pour une valeur de 150,000 francs ? Nous avons vu l’industrie languissante, et sous le joug du numéraire ; nous avons vu deux hommes en présence l’un de l’autre, ayant besoin de leur industrie réciproque, et ne pouvant, faute d’argent, satisfaire à leurs besoins ou à leurs jouissances. Une réflexion bien naturelle nous a amenés à penser, dès lors, qu’en associant ces deux hommes, ils pourraient se procurer ce dont ils auraient besoin. Nous les avons donc associés, ou plutôt leur production et leur consommation, leurs besoins et leurs travaux, et pour qu’ils puissent trouver à satisfaire chacun à ces besoins, les uns vis-à-vis des autres, nous avons émis un signe représentant ces travaux, et ce signe, nous l’avons appelé bon d’échange. Les bornes d’une lettre ne permettent pas de s’étendre longuement sur les bienfaits du bon d’échange ; mais nous pouvons affirmer hautement qu’il y a plus de garantie dans ce signe que dans le signe monétaire, puisque l’un est fictif, et que l’autre repose sur le travail et la facilité de multiplier. Ce signe, en multipliant le travail, concourt à l’augmentation de la fortune et des jouissances publiques. Que M. Fourier se dépêche donc de ne pas encourir les reproches qu’il a si justement adressés aux St-Simoniens et aux Owennistes ; qu’on ne puisse pas l’accuser de rêver le bien sans chercher à sortir de l’ornière de la routine. Certes, il n’est pas d’ornière plus dangereuse en association que celle de l’écu ; car l’écu est désassociateur de sa nature ; il isole les hommes comme le besoin les rapproche. Nous avons quelque peine à concevoir comment le maître en harmonie sociétaire repousse un mécanisme (l’échange) qu’il connaît et qu’il a su apprécier. Nous serions fâchés de trouver dans cette conduite un semblant de susceptibilité, ou un faux-amour propre qui ne devrait point tacher une intelligence aussi élevée. Les doctrines de M. Fourrier étaient presque inconnues en 1824, lorsqu’une voix énergique et généreuse, celle de l’inventeur de l’échange, le présentait au monde industriel comme le chef d’une école qui devait harmoniser la société toute entière. Quoiqu’il en soit, et ce n’est pas seulement notre opinion personnelle que nous soutenons ici, M. Fourier sera obligé, pour arriver à son but, de faire de l’association par échange, comme nous faisons nous-mêmes de l’échange pour et par l’association. Si vous trouvez ma lettre de quelque utilité, veuillez [3.2]l’insérer, Monsieur, dans les colonnes de votre estimable journal, et recevoir l’assurance de tout mon dévoûment. Jul. Dubroca.

Monsieur, L’éloge que vous avez fait de ma conduite, concernant la rectification de l’erreur commise par l’administration, relativement au remplacement partiel des prud’hommes chefs d’atelier, ne m’est pas dû, puisque le fait qui y donne lieu et auquel j’ai, il est vrai, concouru de tout mon pouvoir, appartient à mon collègue, M. Dumas, qui, le premier, m’a tiré du sommeil où j’avais été plongé, quelques jours avant la publication de l’arrêté de la préfecture, par un autre de mes collègues qui, interprétant trop légèrement l’ordonnance royale, parvint à me dissuader de mon premier avis sur cette ordonnance, lequel consistait à la croire seulement modificatrice, et non réorganisatrice ; d’où je pensais que le tirage au sort qu’elle prescrivait n’était destiné qu’à établir l’ordre de service, et non l’ordre de sortie. Aussi, à une lecture plus réfléchie, j’ai de suite témoigné à M. Dumas que je partageais son avis, et je me suis, sans hésiter, associé à ses louables démarches par un acte revêtu de ma signature. Agréez les témoignages de ma considération distinguée. charnier. Ce 8 décembre 1833. Note du Gérant. Le collègue dont M. Charnier parle, comme l’ayant plongé dans un sommeil dont la vigilance de M. Dumas l’a heureusement tiré, est M. Labory. Ce prud’homme avait, en effet, le plus grand intérêt à ne pas courir les chances d’un tirage au sort ; mais il ne réfléchissait pas que si on adoptait son commentaire, il serait le dernier sortant, et par conséquent, outre-passerait de beaucoup le temps légal des fonctions de prud’homme. Nous nous proposions de l’en faire souvenir, si le sort n’était venu nous éviter cette peine. (Voy. ci après Cons. des prud’h.)

Le tirage au sort que nous avons annoncé, et auquel on s’est enfin déterminé, quoi qu’il en ait pu coûter à l’amour-propre de l’autorité, a eu lieu samedi dernier. Les prud’hommes sortans sont, parmi les chefs d’at., MM. Labory, Charnier et Martinon (Ce dernier avait retiré sa démission, nous ignorons pourquoi). Nous n’avons pas encore connaissance du nom des prud’hommes-négocians sortans par la voie du sort. Cependant, il doit avoir eu lieu, la loi étant la même pour tous.

M. labory n’est pas rééligible, attendu son changement de domicile. Il demeure actuellement dans l’arrondissement représenté par M. Bourdon.

M. Naudot, fabricant d’étoffes de soie, rue de la Visitation, n° 5, nous adresse une lettre pour inviter M. Gilbert-Bourget, dont nous avons inséré la lettre dans notre dernier numéro, à passer chez lui.

L’exposition publique au palais Saint-Pierre sera définitivement close le 31 décembre courant.

M. Bebbrugger, disciple de Fourier, donnera trois séances publiques et gratuites, dans la salle de la Loterie, les vendredi 13, lundi 16 et mercredi 18, à huit heures précises du soir. On n’entrera qu’avec des billets que M. Berbrugger remettra chez lui, place Saint-Michel, n° 2.

Une souscription est ouverte en faveur de douze ménages d’ouvriers, victimes d’un incendie chez M. Duernet père, rue de la Bombarde, n° 1.

élections
DÉPARTEMENTALES ET COMMUNALES DU RHONE. – 1833. Le département du Rhône se compose de deux arrondissemens qui ont pour chefs-lieux, le premier, villefranche, et le second, lyon. Le nombre d’habitans, officiellement connu, est de 434,429, dont 142,059 pour l’arrondissement de Villefranche, et 292,370 pour celui de Lyon, savoir : 126,900 à la campagne, et 165,470 à la ville même, répartis dans les six cantons qui la divisent de la manière suivante : 37,690 au premier canton ; 39,935 au deuxième ; 26,955 au troisième ; 27,863 au quatrième ; 13,327 au cinquième ; et 19,689 au sixième. Cette population totale n’a été représentée que par 3,966 électeurs, dont 732 à Villefranche ; 2,603 à Lyon, et 631 dans la campagne lyonnaise. Sur ce nombre d’électeurs inscrits, 2,130 seulement ont voté, savoir : 512 à Villefranche et cantons ruraux ; 1,146 à Lyon, et 472 dans les cantons ruraux. Les 2,603 électeurs lyonnais étaient ainsi divisés : 438 au premier canton ; 666 au deuxième ; 682 au troisième ; 443 au quatrième ; 125 au cinquième, et 249 au sixième ; et les 1146 votans dans cette proportion : 197 au premier canton ; 281 au deuxième ; 297 au troisième ; 182 au quatrième ; 61 au cinquième ; et 128 au sixième. [4.1]Une faible majorité a décidé les élections départementales dans les six cantons dont s’agit : 116 voix au premier ; 126 au deuxième ; 122 au troisième ; 78 au quatrième ; 51 au cinquième ; et 92 au sixième. Les élections du conseil d’arrondissement ont été faites par un nombre de votans encore moindre, savoir : 109 au premier canton ; 170 au deuxième ; 235 au troisième ; 115 au quatrième ; 57 au cinquième ; et 92 au sixième. Voici le tableau, par ordre alphabétique, des membres composant le conseil départemental, et les conseils d’arrondissement de Villefranche et Lyon. Conseil départemental. MM. Berger (St-Laurent-de-Chamousset) ; Boiron père (Villefranche) ; Carret (Vaugneray) ; Chassagneux (Condrieu) ; Corcelette (St-Niz.-d’Az.) ; Deleuillon-Thorigny (l’Arbresle) ; Dorel Gaspard (Monsol) ; Dugas Camille (Givors) ; Duret (St-Genis-Laval) ; Fulchiron (Lyon, 5 et 6e canton) ; Malachard (Beaujeu) ; Matagrin (Tarare), Merlat (St-Symph.-sur-Coise) ; Morel Joseph (Lyon, 4e canton) ; Peyre (Anse) ; Place-Lafond (Belleville) ; Prunelle (Lyon, 3e canton) ; Remond Isaac (Neuville) ; Reyre Clément (Lyon, 1er canton) ; Roaste (Bois-d’Oingt) ; Royer-Vial (Limonet) ; Suchet (Thizy) ; Terme (Lyon, 2e canton) ; Verne-de-Bachelard (Mornant). Conseil d’arrondissement de Villefranche. MM. boucaud (Monsol) ; chanrion (Villefranche) ; drivon (St-Niz.-d’Az.) ; dumas (Belleville) ; gilet (Anse) ; michallet (Bois-d’Oingt) ; moncorger (Thizy) ; sanlaville-janson (Beaujeu) ; varinay (Tarare). Conseil d’arrondissement de Lyon. MM. bouchard-jambon (Vaugneray) ; cadier (Condrieu) ; condamin (Mornant) ; damour (Lyon, 5e canton) ; desprez (Lyon, 6e canton) ; dubouchet (St-Genis-Laval) ; guichard (St-Laurent-de Cham.) ; janson (Lyon, 2e canton) ; joannon-navier (Neuville) ; leguiller (Lyon, 1er canton) ; madinier (Limonet) ; mermet (Lyon, 3e canton) ; peyrachon (St-Simph.-sur-Oise) ; sain-mannevieul (Givors) ; vachon (Lyon, 4e canton).

Misères Prolétaires. La vieille femme qui mendie pour revoir son pays. Une pauvre vieille de 86 ans vient s’asseoir sur le banc des prévenus. M. le président. On vous a arrêtée au moment où vous demandiez l’aumône ? La veuve Florent. Doux Jésus ! que le monde est méchant ! À quoi qu’ça vous sert de me dire cà ? vous devriez bien plutôt me renvoyer dans mon pauvre pays. Ah ! mon Dieu ! si quelqu’un voulait m’y mener ! J’ai 86 ans, et mes pauvres enfans seraient si contens de me voir ! M. le président. Mais la mendicité est un délit. La veuve Florent. Un délit, que vous dites ! Ah ! mon Dieu ! si vous aviez des enfans bien loin, vous seriez bien content de les revoir, pas vrai ? J’en ai un petit de trois ans de la fille de mon aînée ; ils disent au pays que c’est mon fillot ; et je ne l’ai pas encore vu, le pauvre enfant ! (La veuve Florent sanglote.) Je vous en prie à genoux, faites-moi le voir, et puis vous me condamnerez après. Je suis si vieille, ne me faites pas mourir en prison ; je voudrais bien mourir dans mon pauvre pays. La prévenue, en disant ces mots, penche sa tête entre ses mains et pousse des sanglots déchirans. Quelques témoins viennent déclarer que, depuis une année, la veuve Florent est dominée par une seule pensée, celle de retourner dans son pays ; qu’elle se prive même de nourriture pour économiser ses frais de route, et qu’enfin elle s’est décidée à demander l’aumône à quelques passans pour compléter la somme qui lui était nécessaire. En présence de ces déclarations, le tribunal n’a pas hésité à acquitter la prévenue. La veuve Florent, pleurant toujours : Ah merci ! je peux donc aller voir mon pauvre petit fillot ! Que Dieu vous le rende !

Nouvelles générales. [4.2]paris. – Coalition des tailleurs d’habits. – Le tribunal de police correctionnelle a condamné, le 3 décembre, Lemonnier à trois mois de prison, Desroches, Bion, Joanny et Chauffray, à un mois. Vioux a été acquitté. – Les jeunes gens du commerce ont formé entr’eux une association. – La Tribune ayant publié un supplément à son numéro du 16 novembre dernier, spécialement destiné aux ouvriers, ce supplément fut saisi. La police correctionnelle a décidé, le 6 décembre, que la publication de ce supplément, à quelque nombre d’exemplaires qu’il fût tiré, n’était pas une contravention à la loi. – M. Augustin Perrier1, pair de France, frère de Casimir, est mort le 3 décembre, à 59 ans. DÉPARTEMENS. chalons-sur-saône. – Les ouvriers menuisiers viennent de suspendre leurs travaux. Idem. – Les ouvriers bottiers et cordonniers sont d’accord avec les maîtres. Ces derniers se sont montrés justes et même désintéressés. dijon. – M. Paulet, rédacteur en chef du Patriote de la Côte-d’Or, a été acquitté après une brillante plaidoirie de M. Cabet, député. Cet orateur a soutenu que l’impôt sur les boissons était inconstitutionnel, injuste, vexatoire, démoralisateur, et que le refus n’était pas un délit. – Un banquet patriotique a été offert à M. Cabet. st-etienne, Les journaux de cette ville signalent de nombreux accidens arrivés dans les mines, et même une excavation de 60 pieds à peu de distance de la ville. privas. – La cour d’assises de l’Ardèche a condamné à la peine de mort Pierre Martin dit Blanc, Marie Breysse sa femme, et Jean Rochette, leur domestique, tenant l’auberge de Peyrabelle, à raison de divers assassinats par eux commis dans cette auberge isolée. Ils ont été exécutés le 1er octobre, devant leur domicile ; plus de 25,000 personnes ont assisté à cette exécution. versailles. – MM. Dubosc et Dupoty, rédacteurs-gérans du Vigilant de Seine-et-Oise2, accusés d’offenses envers Louis-Philippe, excitation à la haine et au mépris de son gouvernement, ont été acquittés.

Lyon.
Cour d’assises. – Marie Robin, fileuse de laines, a été condamnée le 5 novembre à deux ans de prison, pour un crime qui révolte la nature… Elle avait eu la barbarie de frapper sa mère. Son repentir a pu seul la préserver d’une peine plus rigoureuse et justement méritée. – Samedi prochain aura lieu le procès des cit. Tiphaine, Vincent et Thion. Leur défense est confiée à MM. Jules Favre et Michel-Ange Périer. Tiphaine et Thion doivent prononcer eux-mêmes un discours. littérature et beaux-arts. – La rédaction et la propriété du Papillon viennent de passer entre les mains de M. Léon Boitel. – La bibliothèque de Lyon a acquis, au prix de 250 fr. à la vente après décès du cabinet de M. Gay, le Liber legum regis Alarici, Mes du 8e siècle. – La foule se porte alternativement au palais St-Pierre pour voir l’exposition, et à l’Hôtel-de-Ville où est déposé le tableau de M. Court1, représentant un épisode de la révolution (Séance du 1er prairial, an 3). Evénemens. – Un violent incendie a consumé dans la nuit de lundi au mardi dernier une maison à la montée du Garillan.

cancans.
On ne dira pas qu’il n’y a pas de justice en France, ni que l’égalité ne règne pas devant la loi : on vient de condamner à la réprimande M. PERSIL. On nous communique une chanson qui a pour titre : Alleluia ou le Prud’homme démissionnaire… Nous l’insérerons dans un prochain numéro. M. Lab… est un bon danseur, c’est une justice à lui rendre ; M. le préfet en est convenu lui-même. Ses collègues ne peuvent pas le savoir, puisqu’ils n’y étaient pas ; mais est-il un bon prud’h.... ? Oh ! vous êtes bien curieux. Puisqu’il est à la caisse de prêts, il devrait bien se faire prêter. Et quoi ? de l’argent. Il n’en a pas besoin. Est-ce qu’il n’aurait pas besoin d’autre chose ? Sans doute, mais on n’en prête pas à la caisse de prêts. M. L.... n’est plus prud’homme… Il lui restera encore 6 ou 7 fonctions à remplir.... Tous les cumulards ne sont pas à Paris. M. L.... va s’engager aux Funambules : il jouera le rôle de paillasse et divertira le public par ses bons mots.

Notes (Nouvelles générales. [4.2] paris . – ...)
Augustin Périer (1773-1833) Le Vigilant de Saine-et-Oise. Journal des communes, politique, littéraire et d’annonces, publié une première fois à Versailles entre 1831 et 1834.
Notes (Lyon.)
Il s’agit probablement ici de Joseph-Désiré Court (1797-1865).
|
|
|
|
|
|
|