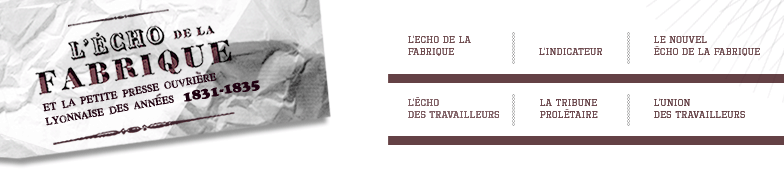Le Journal du Commerce de Lyon contient dans un de ses derniers numéros, une 12e et dernière lettre de M. J.C. Bergeret que nous croyons utile de transcrire ; elle est ainsi conçue :1
« Les chefs d’atelier sont la véritable plaie de la fabrique lyonnaise. Intermédiaire inutile entre le fabricant et l’ouvrier, agent sans action, le chef d’atelier comme le frelon se nourrit et s’engraisse des sueurs et des peines des travailleurs. Grace à sa funeste intervention, l’ouvrier ne reçoit que la moitié du salaire payé par le fabricant, salaire devenu par cette cause tout-à-fait insuffisant pour ses besoins. D’où résulte ce désir constant de faire augmenter le prix des façons, ces nombreuses perturbations de la fabrique et ces fatales divisions qui ont éclaté entre les véritables travailleurs.
« Les chefs d’atelier, dont l’existence tient à ces dissentions, ont eu l’adresse de se placer constamment à la tête des ouvriers, et s’en sont créés les représentans ; ils ont appuyé d’autant plus fortement leurs demandes, qu’elles devaient être pour eux une source plus grande de bénéfices. Pour prendre et conserver cette position, aucun sacrifice ne leur a coûté ; et cela devait être, puisque le jour où les ouvriers auraient fait leurs affaires eux-mêmes, où ils se seraient trouvés seuls en présence des fabricans, l’existence des chefs d’atelier eût été gravement compromise. La mésintelligence entre les travailleurs étant donc pour les chefs d’atelier une question de vie ou de mort, on ne doit pas être étonné qu’elle ait été alimentée avec tant de soins.
« L’intérêt de l’industrie lyonnaise exige donc impérieusement que ces agens sans action, que ces rouages inutiles disparaissent de la fabrique, dont les bénéfices alors seront réservés à ceux qui, par leur travail, y ont un droit véritable.
[1.2]« Pour atteindre ce but, il est nécessaire que l’ouvrier trouve dans le fabricant un appui certain, dans sa caisse une avance suffisante pour acheter un métier, dans sa bienveillante sollicitude l’assurance de son loyer et les moyens de parer ou de prévenir les besoins plus nombreux de l’hiver.
« Avant d’aller plus loin, et afin d’éviter toute confusion, je dois faire observer que l’on désigne sous le nom d’ouvriers ou compagnons tous ceux qui ne possèdent pas leur métier et qui travaillent dans les ateliers ; les propriétaires de ces métiers sont nommés maîtres-ouvriers. Ceci bien entendu, je continue.
« Les ouvriers compagnons se divisent en deux classes : la premiere partage avec le chef d’atelier le prix des façons ; la seconde loue du chef d’atelier un métier, pour un prix mensuel, que celui-ci retient sur le montant du salaire payé par le fabricant.
« La première classe, qui est la plus nombreuse, est aussi la plus misérable, car le prix de son travail ainsi partagé ne peut lui suffire. C’est celle qui cause toutes les crises fâcheuses qui entravent la prospérité de la fabrique. Placée par ses besoins et sa misère sous l’influence immédiate des chefs d’atelier, elle contracte avec eux une communauté d’intérêt qu’il est important de détruire à son profit, et elle leur prête l’appui de ses masses.
« La seconde, généralement plus heureuse, forcée à moins de privations, consomme cependant son temps et ses peines sans en retirer d’autre fruit qu’un malaise moins grand. Il lui faut de longues années ou des ressources étrangères pour acquérir les moyens de devenir maître-ouvrier, c’est-à-dire propriétaire d’un métier. L’influence, quoique moins grande, du chef d’atelier n’en est pas moins encore puissante sur cette classe.
« L’alliance qui existe aujourd’hui entre les chefs d’atelier et les ouvriers est bien évidemment contraire aux intérêts de ceux-ci. Les ouvriers le savent, et pourtant il ne leur est pas possible de s’y soustraire d’eux-mêmes. Il leur faut donc un appui, un secours étranger ; ce n’est que des fabricans qu’il peut leur venir. C’est pour ces derniers un devoir et un besoin de le leur donner ; c’est à eux qu’il appartient de détruire le ver rongeur qui dévore la fabrique lyonnaise, cette classe oisive et improductive des chefs d’atelier qui prive les ouvriers des bénéfices qui leur appartiennent et s’enrichit d’un travail qu’elle ne fait pas.
« Les mesures que j’ai proposées me paraissant propres à obtenir le résultat désiré, je vais les reproduire succinctement, car la question est grave et veut être bien comprise. Les voici : 1° la réduction des impôts qui pèsent sur les denrées de première nécessité ; 2° une meilleure répartition de l’impôt des portes et fenêtres ; 3° l’application des bénéfices de la condition des soies aux besoins de la classe ouvrière ; 4° la création d’une caisse de prévoyance chargée de faire aux ouvriers des avances en nature ; 5° l’avance faite par les fabricans aux ouvriers des métiers dont ceux-ci ont besoin ; 6° et enfin une assurance pour les loyers des ouvriers.
« Ce dernier moyen, que j’émets pour la première fois, me semble indispensable au succès que les autres obtiendront infailliblement. La compagnie d’assurance s’engageait envers les propriétaires qui, n’ayant plus de non valeurs à craindre, abaisseraient le prix des locations, [2.1]et elle se couvrirait de ses engagemens au moyen de retenues opérées sur le prix des façons à payer aux ouvriers. Par cette mesure, ceux-ci seraient affranchis de toute inquiétude d’avenir. »
Nous renvoyons au numéro prochain notre réponse à cette lettre écrite sous une influence qu’il est facile de reconnaître.