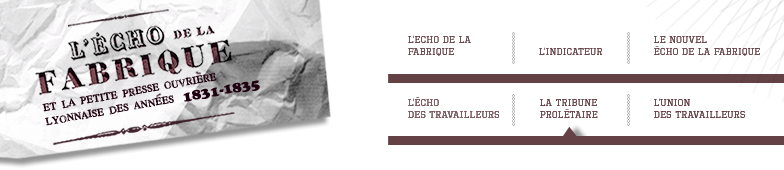|
|
12 avril 1835 - Numéro 15 |
|
|

|
|
| |


|
SUR CES DEUX QUESTIONS. [1.1]Le conseil des prud’hommes est-il compétent pour juger les industries qui ne sont pas représentées dans son sein ? Les chefs d’atelier peuvent-ils prendre en contravention des personnes étrangères à leur industrie, comme occupant des apprentis sortis de chez eux sans livret ? Quoique ces deux questions ne se lient pas nécessairement entr’elles, nous croyons devoir les traiter ensemble parce qu’elles ont plusieurs rapports. La première question est celle de la compétence du conseil des prud’hommes à l’égard des personnes étrangères aux industries, qui sont représentées dans son sein, soit directement, soit par affinité de profession. Cette question nous paraît trop claire pour que nous jugions nécessaire de nous y appesantir. Le conseil des prud’hommes est un tribunal d’exception : il doit se renfermer dans le cercle de ses attributions telles qu’elles sont définies par le décret qui l’institue. Produit de l’élection, s’il en acquiert une force morale, il doit aussi en subir les conséquences, l’une d’elles est que l’élu ne représente que ceux qui l’ont nommé. Tout jugement qui sera rendu en dehors de ses limites sera nécessairement cassé en appel. A l’égard de la seconde question, qui ne s’applique qu’aux contraventions contre des personnes étrangères aux industries, représentées au conseil, la solution ne nous paraît pas non plus douteuse ; il y a déjà long-temps que nous avons promis de la traiter : Notre opinion était, alors comme aujourd’hui que le conseil des prud’hommes est incompétent à l’égard de ces personnes, et pour en convaincre les lecteurs, nous avons inséré dans le numéro 7 (2 nov. 1834) le jugement rendu après délibéré par le tribunal de commerce de Lyon, dans l’affaire Manlius c. Masson. Ce jugement est trop bien motivé pour avoir besoin d’aucuns commentaires. Le conseil des prud’hommes paraît s’être écarté depuis la publication du jugement Masson, de sa précédente jurisprudence, et les incompétences proposées depuis ont été admises. C’est une amélioration à noter dont la presse peut revendiquer l’honneur. Nous savons que quelques chefs d’atelier regardent comme un avantage le privilége que l’ancienne jurisprudence leur accordait de suivre leurs apprentis, en quelque lieu que ce fût, comme le créancier hypothécaire suit un immeuble en quelques mains qu’il passe ; mais nous augurons assez de leurs principes de justice et de liberté pour être convaincus qu’ils s’empresseront de renoncer à tout ce qui est contraire à ces deux bases fondamentales de l’émancipation des prolétaires, aussitôt que des voix consciencieuses et amies leur en auront fait connaître l’injustice. L’homme ne doit en aucun cas être assimilé à la chose. Ce serait établir un servage qui n’est plus dans nos mœurs ; l’esclave seul, et pour la honte de l’humanité, il en existe encore au 19me siècle de l’ère chrétienne, peut être revendiqué par son maître. Mais en France, non seulement il n’y a plus [1.2]d’esclaves ni de serfs, mais depuis 1789 aucune classe de citoyens ne peut prétendre à un privilége quelconque. L’apprenti et sa caution, en cas d’inexécution du contrat d’apprentissage, sont passibles comme tous les autres citoyens qui enfreignent une convention quelconque, de dommages-intérêts, parce que le chef d’atelier ne doit en aucun cas souffrir du caprice de son élève, du changement de volonté de ses parens. Ces dommages-intérêts doivent être en proportion, non seulement de la perte qu’éprouve le chef d’atelier, mais du bénéfice qu’il manque de faire, parce que ce bénéfice est entré justement dans les prévisions du contrat d’apprentissage. Mais là s’arrête le droit du chef d’atelier ; tant pis pour lui s’il n’a pas assuré son paiement ; d’ailleurs doit-il compter pour rien un jugement qui, pendant trente ans, lui permet de saisir les facultés de son débiteur, s’il en acquiert. Mais comment, et à quel titre, vouloir obtenir un paiement immédiat d’un tiers totalement étranger à la convention, et qui, par la nature de son industrie, ne peut causer aucun préjudice au chef d’atelier victime de la mauvaise foi ou de l’inconstance de son apprenti ; qui ne peut retirer lui-même aucun bénéfice des connaissances industrielles de cet apprenti. Cela n’est nullement juste, et il nous semble qu’insister davantage, ce serait entreprendre une tâche puérile, car on ne cherche pas à prouver ce qui est évident. Voudrait-on forcer un apprenti à continuer la profession qu’il a embrassée peut-être avec légèreté de sa part, peut-être contre son gré, et pour obéir à ses parens. Cette prétention serait étrange aujourd’hui ; elle serait un attentat à la liberté, et même au droit que tout homme apporte en venant au monde de vivre en travaillant. Ici nous devons répondre à une objection qui nous a été faite. On nous a dit : l’apprenti qui, par un motif quelconque, ne veut pas commuer l’apprentissage, peut faire résilier sa convention par le conseil ; cette résiliation est inscrite sur son livret, et le chef d’atelier renvoyé à se pourvoir pour obtenir le paiement de l’indemnité ; cette marche bien simple prévient toute difficulté. L’apprenti qui ne l’emploie pas a tort, il commet un délit ; et celui, qui l’occupe sans qu’il ait rempli cette formalité, se rend son complice, et commet en même temps une contravention aux lois de police, qui exigent qu’aucun ouvrier ne soit employé, même comme manœuvre, sans être pourvu d’un livret. Nous n’avons pas dénaturé l’objection. Eh bien ! en l’admettant (et elle nous paraît fondée), on avouera encore que la peine est trop forte, et nullement en rapport avec le délit. A une contravention de police, une amende, c’est juste, mais rien autre. Ainsi nous sommes d’avis que la personne qui recueille l’apprenti ou l’ouvrier d’une industrie quelconque, autre que la sienne, doit être condamné à une amende de police municipale. Quant à cet ouvrier ou apprenti, il devrait être condamné à une amende, plus encore, si on le jugeait convenable, à quelques jours de prison. Peut-être parviendrait-on [2.1]de cette manière plus facilement à la répression des abus dont se plaignent à ce sujet, avec tant de raison, les chefs d’atelier. N’y aurait-il pas un autre moyen préférable de prévenir ces abus ? M. Falconnet l’a indiqué dans son article sur l’apprentissage (Voy. n. 11) ; ce serait d’attacher les apprentis par des récompenses publiques, les seules qui flattent et moralisent l’homme, à l’atelier où ils sont reçus, à leur début dans le monde. Faire considérer à l’apprenti l’atelier de son maître, comme une succursale de la maison paternelle, est une idée vraiment utile, et à la réalisation de laquelle le conseil des prud’hommes doit songer. Alors la question que nous venons de traiter sera devenue oiseuse ; nous y applaudirons de tout notre cœur. Mais en attendant, nous croyons devoir persister dans la solution que nous lui avons donnée.

Dernière réponse, si c’est possible, à l’Indicateur. En faveur de la libre défense. L’Indicateur repousse l’accusation que nous avons portée contre lui d’être hostile à la libre défense. Tant mieux qu’il soit venu à résipiscence ! mais à qui a erré un ton superbe et dédaigneux n’est pas permis. Que l’Indicateur se justifie, rien de plus naturel ; qu’il proteste même contre l’interprétation donnée à une fausse démarche de sa part, rien de plus licite encore ; mais que de l’excuse dont il a besoin il passe à des attaques injurieuses contre une feuille rivale qui, malheureusement pour lui, a compris mieux, et, plus tôt la question, voilà qui n’est pas permis, et c’est ce qui nous force à rentrer dans l’arène de la polémique. Les lecteurs connaissent le sujet des débats entre l’Indicateur et nous. Est-ce notre faute si nous avons interprété comme la majeure partie des ouvriers la note insérée dans son numéro 27, note qui sans cette interprétation n’a aucun sens ? est-ce notre faute si nous avons été l’écho de ceux auxquels M. Dufour a cru devoir s’adresser dans sa proclamation insérée dans le numéro précédent de l’lndicateur, à l’effet de dissiper les doutes qui s’étaient élevés sur son compte ? Il aurait mieux valu ne pas donner naissance à ces doutes par une conduite équivoque, dirons-nous à M. Dufour : personne ne le niera. Qu’averti par la clameur publique du mauvais effet de sa note, l’Indicateur ait jugé utile de rabâcher, en faveur de la libre défense, quelques-unes seulement des nombreuses considérations que nous avons fait valoir bien avant lui ; ce peut être une ruse de guerre légitime, que de s’être ainsi préparé une fin de mon recevoir contre l’attaque qu’il ne doutait pas que nous allions diriger contre lui, mais voilà tout, et nous lui répéterons ce que nous venons de dire à M. Dufour. Au fond le litige tel que, mieux avisé, l’admet aujourd’hui l’Indicateur est peu de chose : Il appelle des vœux ce que nous appelons un mandat ; sur ce sujet nous en avons assez dit dans notre dernier numéro pour être dispensés d’y revenir, ici peut commencer une difficulté sérieuse, et les lecteurs vont être à même d’apprécier le but secret où tend l’Indicateur. Vœux ou mandat, peu importe, dit-il ; « Il suffit pour les prud’hommes que des vœux se soient manifestés pour qu’en homme d’honneur ils fassent tous leurs efforts pour les réaliser. » – Nous avons le droit de le demander ; quels seront ces efforts ? seront-ils de nature à forcer les volontés dissidentes à l’acte de justice qu’on réclame, ou se contentera-t-on de demander humblement ? et si l’on obtient rien comme il est très probable d’après les leçons du passé, que fera-t-on ? Quel est le conseil que l’Indicateur donnera en ce cas ? Allons plus loin : Si un, si deux prud’hommes seulement donnent leur démission, pense-t-il qu’on arrivera au même résultat que si tous les prud’hommes la donnaient ? que l’Indicateur s’explique. Nous soutenons que c’est à tort et contre l’intérêt général qu’il veut séparer les prud’hommes en deux camps. C’est par une union forte et éclairée qu’on obtiendra un résultat, et non par des [2.2]démarches isolées. L’essentiel, c’est d’avoir la libre défense. Nous le disons avec une conviction profonde : on ne l’aura pas, si, au lieu de réclamer l’exécution d’un mandat, quelques prud’hommes déférant à la doctrine commode de l’Indicateur, se contentaient d’apporter l’expression banale de vœux, plus au moins authentiquement formulés. Mais nous cessons ce débat sur le fond de la question parce que le temps n’est pas encore arrivé, et cette polémique, soulevée peut-être à dessein par l’Indicateur, ne peut que faire retarder l’installation des nouveaux prud’hommes, et ajourner d’autant les espérances que la fabrique a conçues. Répondrons-nous à cette assertion de l’Indicateur qu’il a demandé avant nous la libre défense ; oh ! c’est trop fort. Nous ne pensions pas que la vanité pût égarer ainsi quelqu’un. Qui donc a soulevé le premier la question de la libre défense, si ce n’est le rédacteur actuel de la Tribune Prolétaire, dans l’Echo de la Fabrique, aussitôt que la rédaction en chef lui en fut confiée ? Libre à l’Indicateur de feindre l’ignorer, mais tous les ouvriers ne l’ont sans doute pas oublié. Est-ce que la Tribune Prolétaire n’est pas par sa rédaction, seule chose à considérer dans un journal, la suite nécessaire de l’Echo de la Fabrique ; est-ce qu’elle n’y renvoie pas chaque jour ses lecteurs pour éviter de se répéter ? Nous en avons assez dit là-dessus pour 1es hommes de bonne foi : quant aux autres, nous ne parviendrions pas à les convaincre ; il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, et, à vrai dire, nous ne nous en soucions nullement, pas plus que de leur estime. Le dernier paragraphe de l’article de l’Indicateur, mérite une réponse ; elle sera courte, car ces débats sont aussi fastidieux pour le public que pour nous. Il est ainsi conçu : « Si nous voulions ennuyer encore nos lecteurs de la Tribune Prolétaire, nous relèverions les erreurs qu’elle a voulu répandre parmi le peu de travailleurs qui la lisent, et comme le bon sens public ne se laisse pas abuser par ses paroles mensongères, et qu’elle n’a pas l’accent d’une conviction profonde, un désintéressement pur pour s’acquérir des sympathies, il serait donc inutile de relever toutes ses turpitudes, puisque le public l’a jugée avant nous. » Et d’abord, nous n’avons pas vérifié le nombre des abonnés de l’Indicateur, pour le comparer avec le nôtre ; mais fut-il vrai, ce dont on peut douter, que l’Indicateur eut un nombre d’abonnés supérieur au nôtre, quoique ayant paru le même jour, qu’est-ce que cela prouverait ? qu’il n’est pas nécessaire de savoir écrire pour faire un journal, qu’il suffit d’avoir des amis qui le prônent, etc. Alors tant pis : le triomphe de l’émancipation des prolétaires en sera d’autant plus retardé, car ce triomphe ne peut être que le produit de la dissémination des lumières. Au demeurant, n’est-il pas vrai que le Constitutionnel, le Journal des Débats et la Gazette de France sont les journaux qui ont le plus d’abonnés ; sont-ils pour cela préférables au National, à la Tribune, au Réformateur ? La Revue de Paris a beaucoup plus d’abonnés que la Revue républicaine, comparerez-vous ces deux ouvrages ? et sans aller chercher des exemples si loin, n’est-il pas constant que le Courrier de Lyon (il s’en est aussi vanté) a beaucoup plus d’abonnés que n’en avait le Précurseur et aujourd’hui le Censeur. Laissons donc de côté une argumentation aussi futile. Tant mieux pour les actionnaires de l’Indicateur s’ils font bien leurs affaires ; quant à nous, nous n’envions pas leurs bénéfices, nous n’avons jamais pensé que l’établissement d’un journal fut une œuvre lucrative ; mais, prolétaires et hommes de conviction nous avons apporté en tribut à nos frères notre mince fortune et nos faibles talens. Jugez-nous par nos actes, avons-nous dit à tous les travailleurs, et par nos actes seuls, car il est tant de faux prophètes, car la parole est souvent si mensongère… Notre voix a été entendue, elle le sera plus encore, lorsque le charlatanisme qui nous fait obstacle aura fait son temps. Quant à nos erreurs, nous ne sommes pas parfaits, loin de là. Que l’Indicateur ait donc la complaisance de nous les indiquer, et nous nous amenderons. Mais appellerait-il erreurs ce que nous avons dit contre sa boutique d’épiceries, contre son style, contre ses connaissances historiques, [3.1]oh ! alors nous mourrons dans l’impénitence finale. Nos turpitudes : cela change, mais l’Indicateur n’est pas puriste et il regarde même, s’il faut en croire notre spirituel et patriote ami Roussillac, comme un attentat à ses doctrines tout ce qui tend au purisme ; l’Indicateur ne connaît pas la valeur des mots, voilà sa meilleure excuse. Nous lui répondrons simplement que nous ne sommes pas d’effrontés plagiaires, comme il l’a été notamment dans son n° 27, en s’appropriant un article de M. Arles-Dufour et en faisant dire à cet auteur le contraire de ce qu’il disait ; bien plus, nous n’avons jamais été chez les dépositaires de ses prospectus retirer le montant d’abonnemens perçus pour autrui, sauf à restituer ainsi qu’il l’a fait ; ce sont là des turpitudes, que l’Indicateur ne l’oublie pas.

AU RÉDACTEUR.
J’ai promis dans la précédente lettre que vous avez eu la complaisance d’insérer dans votre dernier n°, de continuer l’examen critique du système de M. Derrion. Nullement habitué à écrire, vos lecteurs voudront bien excuser mon peu de méthode et quelques négligences de style. Ouvrier comme eux, je viens leur rendre compte de mes impressions, et si elles sont défavorables à l’entreprise de M. Derrion, ce n’est par aucun motif de haine personnelle ou de jalousie. En livrant à la publicité sa doctrine, M. Derrion s’est soumis aux chances de la discussion ; il n’a sans doute pas espéré ne trouver que des adhérens, et il ne pousse pas le fanatisme jusqu’à dire, avec Mahomet : crois ou meurs. Ce préliminaire posé, j’entre en matière. Monsieur Derrion est marchand-fabricant, il n’a aucune connaissance du commerce de l’épicerie ; il doit en avoir de celui des soieries. Pourquoi fait-il une tentative de réforme sur un commerce auquel il est étranger, au lieu sur un commerce qu’il pratique. J’ai toujours entendu dire qu’il fallait joindre l’exemple au précepte. M. Derrion serait-il de ces apôtres qui disent confidentiellement à leurs ouailles : faites ce que nous vous disons et ne faites pas ce que nous faisons. Je serais tenté de le croire ; j’attends sa réponse à ce sujet. En admettant que M. Derrion ait choisi le commerce de l’épicerie, comme le plus lucratif ou comme étant d’une conception plus facile et d’un usage plus habituel ; je lui demanderai s’il a bien calculé les fonds nécessaires pour entreprendre ce commerce et les chances de réussite. A cet égard, je ne parlerai pas d’après moi-même, mais d’après des personnes plus éclairées. Je me suis informé auprès d’un négociant en épiceries retiré des affaires depuis peu, de ce qu’il pensait du système de M. Derrion, voici ce qu’il m’a dit sinon dans les mêmes termes, du moins à peu près : « Il faut pour monter une boutique d’épiceries assortie et propre à desservir un grand nombre de pratiques, au moins 30,000 francs. – Pour vendre au détail et tenir des écritures régulières d’une pareille vente, il faut un personnel nombreux, et on ne saurait évaluer, à moins de 6,000 francs, les frais. – C’est ce qui explique la division du commerce d’épiceries en quelques maisons faisant le gros, quelques autres, en plus grand nombre faisant le mi-gros, et en un nombre infini de boutiques de détail. – Si toutes les boutiques de détail étaient absorbées par une seule, comme dans le système Derrion, ce serait l’arche de Noé ou la tour de Babel. – D’un autre côté, a-t-il ajouté, il n’y a pas d’épicier au détail qui n’associât le quartier qu’il exploite, à un quart de son bénéfice (comme le propose M. Derrion), si on lui fournissait les fonds à avancer pour les achats, et si on lui garantissait, soit la mévente soit les crédits. » – Il en concluait que dans le système de M. Derrion, il fallait supprimer le crédit cet agent de la civilisation, et que toutes les ventes fussent au comptant ; qu’autrement la maison ne pourrait pas se soutenir attendu qu’il arrive souvent que sur trois acheteurs l’un paye comptant, l’autre fort tard, le troisième jamais, ce qui nécessite de la part du marchand une hausse dans ses prix, hausse à laquelle il renoncerait de bon cœur si on voulait lui assurer la totalité de ses rentrées. – D’après ce, j’en ai conclu que le système de M. Derrion n’avait rien de bien merveilleux, et que malgré sa philanthropie dont je ne veux pas douter, M. Derrion conduisait mal les travailleurs qui ont foi en lui. Puissent ces simples observations les amener à réfléchir et à conserver leur argent pour des entreprises plus véritablement productives. J’attendrai les réponses de M. Derrion aux objections que je viens de présenter, et je souhaite qu’il puisse me convaincre de la bonté de son système, car je n’ai aucun sentiment hostile. Je cherche la vérité et voila tout. S’il ne répond rien son système sera jugé. J’ai l’honneur, etc. GAUTHIER. N. D. R. Nous accueillerons la réponse de M. Derrion, sauf à la faire suivre de nos propres réflexions.

Nous avons reçu de M. charnier, prud’homme, rapporteur dans l’affaire Perrichon c. Duchêne (Voy. n° 13), la lettre suivante, qui n’a pas pu trouver place dans notre dernier numéro. Ce 31 mars 1835. M. le Rédacteur. Je lis dans votre dernier numéro, un article relatif au jugement [3.2]rendu par le conseil des prud’hommes et confirmé par le tribunal de commerce, entre les sieurs Perrichon et Duchêne. Je n’ai pas à m’expliquer sur le mérite de ces décisions, mais je dois vous, déclarer, pour rendre hommage à la vérité, que c’est mal à propos que vous attribuez la réduction de l’indemnité stipulée dans le contrat d’apprentissage, au rapport que j’aurais fait comme prud’homme lequel aurait déterminé le conseil à s’écarter du texte précis de l’art. 1152 du code civil, en considération des torts du chef d’atelier. Le sieur Perrichon n’a eu aucun tort envers son apprenti. Ce dernier n’a élevé aucune plainte, loin de là, il m’en a fait l’éloge, et s’il a voulu quitter ce n’est que par suite de l’inconstance naturelle au jeune âge et pour embrasser la profession de bossetier. J’ai dû rétablir la vérité des faits, afin de ne pas laisser peser sur le sieur Perrichon un blâme qui semble planer sur lui, et dont vous avez si bien fait ressortir les conséquences. J’ai l’honneur d’être, etc. CHARNIER. N. D. R. Il résulte de la lettre ci-dessus, que loin d’être défavorable au sieur Perrichon, le rapport de M. Charnier établissait que la demande en résiliation du contrat d’apprentissage, formée par Duchêne, provenait seulement d’un caprice de l’apprenti. Ainsi tombe le premier considérant du tribunal de commerce. Maintenant il ne repose plus sur rien, ou plutôt il repose sur un fait reconnu faux. Il n’était pas suffisant avions-nous dit, de s’en référer au rapport du prud’homme délégué, il fallait faire connaître les motifs de son avis, puisque le tribunal les adoptait, et nous pensons avoir eu raison. Que dirons-nous aujourd’hui que les conclusions de ce rapport nous sont dévoilées ? Le tribunal n’aurait pas commis cette erreur si, avant de juger, il avait voulu connaître l’opinion du prud’homme rapporteur. Quant au conseil des prud’hommes, sur qui pose la responsabilité du premier jugement, il avait délégué M. Charnier ; pourquoi n’a-t-il pas adopté l’avis de ce membre du conseil ? Quels nouveaux faits sont venus le forcer de manquer ainsi d’égards à l’un de ses membres, en jugeant contrairement à son avis, non pas sur une question de droit, ce qui serait naturel, mais sur une question de fait, ce qui est bien différent. En vérité il ne valait pas la peine de le nommer si on ne voulait pas s’en rapporter à lui. Nous le répéterons encore ; puisque le conseil jugeait contrairement à l’avis de son rapporteur, il devait dire pourquoi. En définitif, on le voit, la logique est la sauvegarde de la loi.

CONSEIL DES PRUD’HOMMES.
Séance du 9 avril 1835. Président M. Riboud, Membres : MM. Blanc, Chantre, Cochet, Dufour, Dumas, Ferréol, Jubié, Micoud, Perret, Roux, Vérat, Wuarin. 17 causes sont appelées dont 3 sur citation. – Cinq ont été arrachées, 2 jugées par défaut, 4 renvoyées à huitaine, 1 au 7 mai, les autres ont été jugées contradictoirement. comte (Joseph) c. comte (Pierre). Les questions à juger étaient celles-ci : Un apprentissage peut-il être contracté pour un certain nombre de pièces au lieu de l’être pour un certain temps ? – Non. Le chef d’atelier qui ne s’est pas conformé à l’usage de la fabrique, dans le contrat d’apprentissage, perd-il son droit à toute indemnité ? – Oui. Joseph Comte avait pris sa nièce en apprentissage, et il était convenu qu’elle ferait quinze pièces, ensuite de quoi il lui ferait avoir un livret. La Dlle Comte n’avait fait que cinq pièces et avait quitté l’atelier de son oncle. Ce dernier demandait qu’elle rentrât ou payât une indemnité. Le conseil a blâmé Joseph Comte de cette forme insolite d’apprentissage, l’a débouté de sa demande en indemnité, et ordonné que la Dlle Comte se replacerait comme apprentie, pendant un an. monfalcon, bret c. sivoux. Questions à juger. Le chef d’atelier a-t-il le droit de soumettre ses apprentis à une retenue sur leur salaire, en cas d’absence sans cause légitime de leur part ? – Oui. La stipulation du remplacement du temps perdu, ne doit-elle s’appliquer qu’au temps perdu par suite de maladie ou cas de force majeure, et non pour absences volontaires ? – Oui. [4.1]Sivoux avait retenu cinq francs à Bret et Monfalcon, deux de ses apprentis, pour avoir absenté sans cause légitime de son atelier. Le conseil lui a donné gain de cause et l’a de plus autorisé à faire afficher dans l’atelier le jugement. pradel c. ginet et Ce. Pradel est créancier de Ginet et Ce de la somme de 1,700 f. dont il réclame le paiement ; mais comme par ses conventions, il doit subir quelques retenues pour n’avoir pas rendu l’ouvrage dans les délais fixés, le conseil a ordonné que Ginet et Ce donneraient dès le lendemain un fort acompte, et que pour le réglement ils se retireraient demain lundi au greffe devant MM. Perret et Troubat. Le conseil a blâmé MM. Ginet et Ce de ne pas s’être libérés plus tôt d’une partie de leur dette, en gardant seulement une somme suffisante pour faire face aux retenues à faire à Pradel ; de plus, M. le président a paraphé, séance tenante, tous les feuillets du livre du chef d’atelier, ne varietur.i
i. Nous pensons que M. le président a donné par là un sage exemple aux chefs d’atelier, car sans cela et si dans son esprit ce n’était pas une mesure d’ordre public à introduire, ce serait une injure à MM. Ginet et C e. On fera donc bien à l’avenir de ne jamais laisser de blancs sur les livres. MM. les négociants ne devraient pas se le laisser dire si souvent ; il en coûte si peu pour contenter tout le monde et mettre fin à des bruits que nous sommes portés à croire calomnieux, mais qu’il serait bon de ne pas laisser naître, que nous sommes étonnés de la répugnance des négociants à se conformer à cette méthode.

avis utile au commerce et aux hommes d’affaires.
Aux termes de l’article 11, titre 2 de la loi du 27 mai 1791, les receveurs de l’enregistrement ne sont tenus d’avoir leur bureau ouvert que pendant huit heures consécutives ou en deux séances, et ils doivent arrêter leurs registres immédiatement après sa fermeture. Des ordres sévères sont venus récemment les rappeler à la stricte observation de cette règle. Il en résulte un grand inconvénient pour les porteurs d’effet sur papier libre. On sait que ces effets sont soumis à une amende avant le protêt qui doit être fait, à peine de nullité, le lendemain de l’échéance. Néanmoins, beaucoup de négocians ont conservé l’usage abusif d’accorder délai aux débiteurs jusqu’à ce même jour avant midi. Ce n’est qu’après cette heure qu’ils portent leurs effets restés en souffrance aux fonctionnaires (notaires ou huissiers) chargés de protester. Ces fonctionnaires ont également l’habitude qu’on ne saurait cependant blâmer, d’aller (contrairement à la loi) constater le défaut de paiement avant de faire viser pour timbre. De toutes ces complaisances, il résulte bien souvent, que lorsque le fonctionnaire chargé du protêt se présente au bureau du receveur pour faire amender les effets dont il vient de constater le non-paiement, ce bureau est fermé et le registre arrêté. Cependant la loi dispose (code de proc. civ. art. 1037) que les huissiers peuvent vaquer à leurs fonctions depuis 6 heures du matin jusqu’à 6 heures du soir, du 1er octobre au 31 mars, et depuis 4 heures du matin jusqu’à 9 heures du soir, du ler avril au 30 septembre. Les notaires ont par analogie le même droit. Ils ont encore intérêt à la solution de cette question pour d’autres actes, notamment les déclarations de commande qui doivent être faites pendant les vingt-quatre heures, pour être affranchies du droit proportionnel de mutation. Ils peuvent aussi être arrivés au dixième jour de la date d’un de leurs actes et avoir oublié de le faire enregistrer. Nous nous sommes enquis des moyens de lever cette difficulté, et nous avons appris qu’une décision du ministre des finances, en date du 15 janvier 1834, porte que dans le cas de la fermeture du bureau avant l’heure légale, c’est-à-dire avant l’expiration du temps pendant lequel les fonctionnaires judiciaires peuvent exploiter, il faut faire constater par un procès-verbal d’huissier la présentation de l’acte dont on requiert l’enregistrement, ou de l’effet qu’on veut faire viser pour timbre. En cas d’absence ou de refus de la part du receveur, l’huissier se conforme aux dispositions de l’art. 1039 du code de procédure civile.

[4.2]Le Censeur, dans son numéro de vendredi dernier, après avoir rendu compte de l’arrêt de la cour qui condamne le gérant de l’Indicateur à un mois de prison et 600 fr. d’amende, ajoute : « Nous ne savons guère ce que la prospérité publique peut gagner à l’anéantissement de la presse populaire ; mais à coup sûr, des passions violentes qui fermentent au sein des masses sont moins excitées par les exagérations possibles d’une rédaction peu éclairée, etc. » Si le Censeur n’a entendu parler que de l’Indicateur, nous n’avons rien à dire ; chaque journal doit se défendre lui-même ; d’ailleurs il n’aurait fait que suivre l’exemple de Me Jules Favre qui dans sa plaidoirie, a déclaré ne rien comprendre à la doctrine de son client, et n’avoir pas à en défendre la rédaction : mais le Censeur n’aurait pas dû oublier que l’Indicateur n’est pas lui seul la Presse populaire ; faute de cette distinction, nous sommes obligés de prendre pour nous une part dans la mercuriale du Censeur et d’y répondre. Nous consentons volontiers, quoiqu’il en puisse coûter à notre amour-propre d’auteur, à reconnaître que notre rédaction est bien loin d’être aussi savante que celle du Censeur, mais si par ces mots peu éclairée, le journal qui a succédé au Précurseur prétend nous accuser d’erreurs, il nous semble qu’en bon confrère, et dans l’intérêt de la classe ouvrière, il aurait dû nous en avertir plus tôt et signaler ces erreurs. Mais nous n’acceptons pas le reproche d’exciter les passions par nos exagérations, et il a fallu nous assurer que c’était bien le Censeur qui s’exprimait ainsi, car cette phrase paraît empruntée au Courrier de Lyon. Nous mettons au défi le Censeur de trouver aucune exagération dans tout ce que nous avons écrit dans l’Echo de la fabrique, l’Echo des travailleurs et la Tribune Prolétaire qui les remplace. Nous ne savons donc à quoi attribuer la malveillance de notre confrère pour la presse populaire. M. Anselme petetin nous avait accoutumés à d’autres procédés.

CHARADE. L’un après l’autre avec délice
L’avare entasse mon premier,
Et faute de si peu, pourtant en son grenier
Il faut parfois que l’indigent périsse.
La feuille que flétrit l’automne jaunissant
Tombe et de mon dernier est bientôt le caprice ;
Pour deviner mon tout il faut penser souvent.

(42-1) Le jugement rendu en 1er ressort qui avait condamné les sieurs Belly, Jaud, Delaigue et Bailly aux dépens, à l’amende, à des dommages envers le sieur david et à la confiscation de l’objet contrefait (l’Arbre Central principal moteur dans la mécanique à dévider de forme ronde dont ce dernier était breveté), vient d’être confirmé le 3 de ce mois par le tribunal civil de Lyon. Le public est prévenu que le sieur david, mécanicien, place Croix-Paquet, est le seul qui puisse confectionner et vendre ces nouvelles mécaniques pour les dévidages et cannetages, ensemble ou séparément, qui apportent une grande économie à la fabrique. Il fait des échanges pour les vieilles et revend celles-ci toutes réparées. (43-1) A louer à la St-Jean prochaine, un appartement propice pour atelier quelconque, ayant cave, grenier et réservoir d’eau. Impasse St-Clair, n. 7, s’y adresser chez M. revolat, imprimeur. SERVICE DE LYON A CREMIEUX,
(57-1) voiture suspendue, à 13 places d’intérieur et 4 au coupé ; faisant le trajet en quatre heures. Prix 1 fr. 65 c.
Elle part tous les jours de Lyon à deux heures après midi, et de Crémieux à six heures du matin.
On la prend à Lyon, chez leroy, cafetier, au temple de mémoire, quai Bon-Rencontre. (39-2) A VENDRE Un métier de courant, avec mécanique en 600, et un rouet à canettes. S’adresser à M. Tondat, rue Confalons, n. 6, au 5me, en face la Halle-au-Blé. (40-1) A louer. Un appartement de deux pièces au second, rue Masson. S’adresser comme dessus. (41-1) On demande à acheter un métier de velours en bon état. S’adresser au bureau.

|
|
|
|
|
|
|