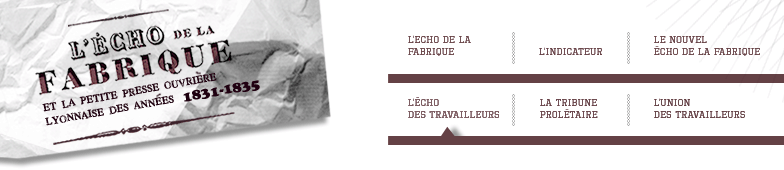|
|
9 novembre 1833 - Numéro 3 |
|
|

|
|
AVIS. [1.1]Ce journal s’adresse à toutes les classes de Travailleurs. Il n’est pas le journal spécial d’une industrie, mais celui de toutes.

DES TRAVAILLEURS.
L’homme est doué de deux sortes de facultés : physiques et intellectuelles. La nature les lui donne dans une proportion plus ou moins forte ; l’éducation et l’usage les développent. L’éducation sans l’usage deviendrait bientôt inutile ; l’usage ne peut venir que de l’éducation (nous prenons le mot éducation dans le sens général qu’il doit avoir). Quiconque fait usage, c’est-à-dire, emploi des facultés physiques ou intellectuelles dont il a été plus ou moins abondamment pourvu par la nature, est un travailleur. Quiconque n’en fait pas usage est un oisif. C’est pour les premiers que nous écrivons, c’est à eux que cette feuille s’adresse. On le voit, notre cadre est immense, il embrasse toute la société active et pensante. Nous n’avons garde de restreindre le mot de travailleurs aux hommes qui ne s’occupent que de travaux manuels ; nous désignons aussi par ce mot ceux qui s’occupent de travaux intellectuels. Ces derniers, nous les appellerons, si cette expression est permise, des artisans de la pensée. Dans cette catégorie viennent se ranger tous les hommes de lettres, tous les artistes ; nous devons donc aussi écrire pour eux. Leurs travaux ne sont pas à dédaigner, puisque sans eux les facultés intellectuelles créées par la nature seraient stériles ; dès-lors une confraternité doit exister entre tous. Les uns ont exalté les facultés de l’esprit aux dépens de celles du corps, et réciproquement ; heureux ceux qui les réunissent toutes. Notre but est donc de rétablir l’équilibre entre ces diverses facultés, car elles sont toutes dans la nature. L’usage seul ou l’éducation a modifié les unes au détriment des autres : en effet, l’artisan des travaux manuels est loin d’être privé de facultés spirituelles ; l’artisan des travaux de l’esprit n’est pas non plus privé de la force physique nécessaire pour l’accomplissement des travaux manuels. Le bon sens du maraud m’épouvante est une pensée plus vraie qu’on ne le croit communément. Descendez dans toutes les classes de la société, même dans celles que l’orgueil appelle basses classes ; prenez un homme dans la force de l’âge, mettez-le à son aise et vous serez étonné des réflexions, de la science naturelle de ce prolétaire ; il ne lui a manqué que l’éducation. C’est donc à donner aux prolétaires cette éducation qui développera leurs sens moraux, comme la gymnastique [2.1]développe les sens physiques, que doivent tendre tous les efforts des hommes philantropes. Alors l’équilibre étant rétabli, les hommes forts, les prolétaires jouiront de toutes leurs facultés, suivant un degré plus ou moins éminent, tel que la nature les en aura gratifiés. Par conséquent, la moralité se trouvera réunie à la force. Une race nouvelle, c’est-à-dire régénérée, prendra possession du globe, et l’émancipation de la classe prolétaire ne sera plus un problême ; il n’y aura plus ce que dans son langage insultant l’aristocratie appelle populace. Eclairé par la dégustation du fruit que l’arbre de ;la science produit, Adam eut honte de sa nudité : éclairé par la dégustation d’un fruit pareil, l’Adam social aura honte aussi de sa nudité. C’est donc une œuvre d’avenir que nous entreprenons ; il ne nous sera peut-être pas donné de voir l’accomplissement de nos désirs, mais quelqu’éloignée que puisse être la réussite, nous devons marcher pour atteindre le but. Ce but, nous l’avons déja proclamé ailleurs, en le formulant ainsi : égalité sociale (V. l’Echo de la Fabrique, 1832 ; n. 30, 31, 33 et 34). Par égalité sociale nous entendons une condition uniforme de bien-être, résultat d’un accord parfait, d’un développement intégral dans tous les hommes de leurs facultés morales et physiques ; ce qui n’existe pas encore. Voila pourquoi nous nous adressons aux travailleurs, car c’est eux qu’il est urgent de moraliser, c’est à eux qu’il est utile de faire comprendre que leur bien-être physique dépend de leur bien-être moral, et qu’un homme n’est entier ou pour mieux dire complet, que lorsqu’il jouit de tous deux. Nous n’avons rien à dire aux oisifs ; qu’ils consument en paix leur vie inutile, qu’ils se gorgent de jouissances achetées, eux, inhabiles à produire d’autres jouissances pour leurs semblables. L’état social, par suite de ses transformations successives, se trouve aujourd’hui divisé en deux camps : celui des travailleurs ou prolétaires, celui des oisifs ou non producteurs. Nous avons planté notre drapeau dans le camp des premiers, nous saurons le défendre. Marius Ch.

Association commerciale d’échanges. Dans l’état actuel des usages sociaux tels qu’ils sont établis (l’achat, la vente, le prêt), un homme qui fait le commerce ne fait autre chose qu’échanger des marchandises ou des travaux contre d’autres marchandises, ou d’autres travaux, en opérant les échanges moyennant l’intermédiaire de deux agens accrédités par les lois, les écus et les billets, avec lesquels on traite de deux manières : la vente au comptant et la vente à terme. [2.1]Entre ces deux modes de commerce la différence est grande. Dans la vente au comptant, il y a paiement immédiat et presque toujours bénéfice certain et par conséquent possibilité de rendre au travail les capitaux recouvrés, et d’entretenir ainsi la continuité du mouvement industriel (les ventes et les achats). Dans la vente à terme, au contraire, le paiement est éloigné, la disponibilité des capitaux retardée, les bénéfices quelquefois compromis, et le capital lui-même très souvent perdu par tels accidens qui, dans l’intervalle, viennent ébranler la fortune de l’acheteur au détriment du vendeur. Dans la première hypothèse, les détenteurs du numéraire exercent une véritable suzeraineté aussi avantageuse pour eux que désastreuse pour ceux sur qui ils l’exercent. Dans la deuxième hypothèse, les acheteurs à terme paient des escomptes usuraires, achètent plus cher, vendent le plus souvent à meilleur marché, sont exposés aux protêts, aux remboursemens, aux faillites, deviennent la proie des huissiers, des avoués. Les détenteurs du numéraire, au contraire, perçoivent les escomptes et les usures, font les affaires sans presqu’aucun risque et avec des bénéfices certains ; la disponibilité de leurs capitaux abaisse pour eux le prix des denrées, et leur ouvre le champ des spéculations. Il y a, en un mot, dans le monde commercial deux classes bien distinctes, celle qui exerce les vexations, celle qui les endure, celle qui perd, celle qui gagne, celle qui souffre et celle qui jouit. Un tel discord, une telle incohérence, un pareil conflit dans les relations sociales, ne pouvaient demeurer plus long-temps inaperçus en présence d’un siècle de lumière et d’intelligence. L’exploitation de la misère publique était trop manifeste, il fallait donner un auxiliaire au numéraire qui est beaucoup trop stagnant pour les industriels ; il fallait anéantir l’éventualité que présentent les crédits, il fallait trouver le moyen de réduire toutes les affaires au comptant ; il fallait procurer un débouché rapide aux produits du sol et de l’industrie, et éviter qu’ils séjournassent en magasin après leur confectionnement, au grand détriment de ceux qui les produisent ou de ceux qui les détiennent. Dans ce dernier cas, en effet, le producteur qui éprouve du retard à rentrer dans ses avances et qui cependant a besoin d’utiliser son temps en travaillant, se voit contraint d’user de son crédit pour se procurer les matières premières, nécessaires à son travail. Il paie son vendeur avec une obligation dont il espère réaliser le montant, et par contre-coup il se voit souvent obligé d’accepter de l’acheteur de ses produits, des effets dont il espère être payé. Ce système d’espérance et de promesse, d’éventualité et de hasard, gagnant de proche en proche, donne naissance à une foule de combinaisons qui, en s’étayant mutuellement, forment une chaîne continue de surprises et de déceptions que la moindre commotion industrielle ou politique ébranle et désorganise. Pour remédier à un état de choses aussi fâcheux et toujours renaissant, l’association commerciale échange l’une contre l’autre deux valeurs réelles (denrées, marchandises ou travaux), au lieu d’échanger une actualité (un produit) contre une promesse (billet). Elle met enfin l’offre et la demande en association et en rapport à l’aide d’un nouvel instrument d’action (le papier ou bon d’échange) établissant entre la production et la consommation un mouvement de rotation perpétuelle. Ainsi cesseront peu à peu, par le secours puissant de ce simple et ingénieux mécanisme, la misère, les privations, le désœuvrement d’une partie de la population, les catastrophes, les faillites qui se succèdent sans relâche, dont la raison seule se trouve dans l’insuffisance de la circulation du numéraire, l’éventualité des crédits, et la routine qui préside encore à nos relations commerciales. Un coup-d’œil rapide que nous jetterons encore sur les causes principales de désordres et de perturbations qui agitent convulsivement l’ordre social, ainsi que sur les avantages immenses que le développement du système d’échange composé peut procurer aux capitalistes, [2.2]aux propriétaires et aux industriels, fera sentir, nous l’espérons, la vérité de cet énoncé, et disposera les esprits à apprécier l’importance et l’utilité du système pratique d’échanges et d’association que nous réalisons à Lyon ainsi que dans toutes les villes de France et de l’étranger. laget.

boutade sur l’éducation.
Je n’aime pas cette fatuité intolérable qui, pour avoir été élevée au collége, se croit en possession exclusive du génie, et s’émerveille d’en trouver ailleurs que chez elle. Vous la voyez, trônant sur un amas de grammaires, de billets de banque et de parchemins, jeter au loin les yeux et s’écrier : « Mais ceci n’est pas mal, cela est très surprenant pour un homme sans éducation ! » Comme si l’on ne pouvait parler et penser qu’après avoir fait ses classes ; comme si, dans le temps étrange où nous vivons, d’autres écoles plus instructives ne s’ouvraient pas devant nous. Telle est l’éducation absurde qui règne depuis long-temps sur l’Europe, que moins on reste soumis à son influence, plus on a de chances pour conserver son jugement sain et sa pensée active. Les Rousseau, les Shakespeare, les Byron, ont-ils eu beaucoup à se louer de leur éducation ? Leur véritable école, leurs études plus réelles, n’ont-elles pas été la peine, la misère, l’isolement, la faim, la douleur ? N’est-ce pas dans ce sol ingrat qu’ils ont prospéré et fleuri, comme ces grands arbres des forêts, dont la semence, jetée au hasard sur le granit, brave les saisons et le temps, lutte, souffre, s’ouvre un passage dans les interstices du roc, croît au milieu des tempêtes, oppose à la bise et à la chaleur un tissu qui devient plus serré, plus puissant en proportion de la résistance qu’il doit offrir et de la stérilité de la sève, se développe enfin, renverse de sa racine triomphante le berceau qui l’a nourri, et devient chêne. « Il n’y a, comme le dit très bien un homme qui a écrit sur l’agriculture, il n’y a que l’artichaut qu’on ne puisse faire pousser ailleurs que dans un jardin ; le chêne pousse seul, en tout lieu, et trouve sa substance dans le plus maigre sol. Si vous l’environnez d’engrais, il dépérit ; abandonnez-le à lui-même, vous le verrez croître et s’élancer, son tronc noueux faire jaillir mille rameaux, et sa tête royale se couvrir d’une couronne de feuillage. » De même, si j’avais besoin d’un homme de cœur et de résolution, d’une tête saine et forte, d’un jugement dégagé de préjugés, d’un ami qui connût les hommes et le monde, ce serait un homme du peuple que je choisirais ; non un de ces esprits débilités et contournés par le luxe du savoir et des jouissances, pleins de rêveries inapplicables et dangereuses, de petites ruses inventées par la vanité, d’adresse à simuler toutes les vertus, de babil sans grandeur d’ame et de hauteur sans courage. Oui, celui qui gagne chaque jour ses alimens à la sueur de son front, en sait plus que le fat bien élevé qui court de concert en concert, de salon en salon. Les ressources sans nombre dont notre siècle abonde apportent au riche trop de jouissances, sont trop complaisantes pour la sensualité, trop faciles au vice pour ne pas favoriser les mauvais penchans. Ce que l’éducation semble faire, la mollesse, le luxe, les habitudes sociales le détruisent ; et, tandis que le jeune apprenti, devant son étau ou son établi, conserve l’énergie de sa pensée avec la puissance de son corps, le jeune pair, auquel toutes les jouissances intellectuelles sont prodiguées, devient incapable de les sentir. Mais il est faux que l’éducation n’existe pas pour le peuple. Les livres sont partout, les livres où se trouve le grand mystère du passé, où la pensée de l’homme se déploie avec ses mille conquêtes dont elle s’est rendue maîtresse. La plus étroite hutte est un lieu d’éducation, pourvu qu’il s’y trouve un livre. La civilisation, c’est l’alphabet, symbole universel et impérissable de ce que notre race a inventé, appris, deviné, senti, accompli, imaginé depuis qu’elle est au monde. Où est l’expérience des siècles ? Comment les découvertes et les instructions des temps passés arrivent-elles jusqu’à nous ? de mille manières : dans les livres, les tableaux, les traditions, les mœurs, le langage. La roue d’une machine [3.1]à vapeur communique au paysan un savoir plus profond que celui de Socrate. Qu’est-ce donc que cette science, sans puissance et sans utilité, science de lettre morte, science de mots et de formes, que vous préconisez si haut et qui n’embrasse point la nature, ne la pénètre et ne l’approfondit pas, ne dévoile pas un mystère de la vie, et que cependant vous osez appeler exclusivement et emphatiquement la science ? Il y a bien plus de science dans ce métier qui, mis en activité, produit comme par enchantement ces tissus, ces rubans-gaze dont l’éclat et le dessin le disputent aux plus belles fleurs ; c’est le résultat de tant de combinaisons et de découvertes. Le vrai maître d’école, c’est la pratique, et le savoir appartient à tous. Il est vrai que l’homme de génie, né dans le luxe et élevé pour l’inaction, peut triompher des obstacles ; mais le paysan, l’artisan, privés de toute instruction classique, peuvent vaincre aussi leur situation. Qui préférez-vous de cet écrivain fashionable dont l’imagination, pareille à ces bouffées de vent qui roulent en même tas la poussière des rues et les paillettes d’or, enfante un roman par semaine, et de cet ouvrier modeste qui a porté si haut la fabrication de vos étoffes et de vos rubans ? Lequel vous est le plus utile ?… Choisissez deux intelligences, deux hommes doués de talent : placez l’un dans une mauvaise imprimerie où il faut travailler de huit heures du matin jusqu’à huit heures du soir ; renfermez l’autre dans l’enceinte d’un collége pourvu de professeurs et de belles bibliothèques : l’un de ces hommes sera Franklin, l’autre Saumaise ou Scaliger1. Lequel est le plus grand ?…

Les personnes qui ne voudraient pas s’abonner au présent journal sont priées de refuser le prochain Numéro, autrement nous les considérerons comme abonnés.

Au rédacteur. Monsieur, Permettez-moi d’emprunter les colonnes de votre journal pour donner de la publicité à un fait qui, par sa nature, intéresse toute la ville. Dimanche dernier, je me retirais du café Achard, quai de Flandres, lorsqu’à environ 25 pas de la maison où j’habite, rue de Noailles, n. 3, je fus assailli par trois hommes qui me suivaient depuis un moment. Je n’ai dû, dans cette circonstance, mon salut qu’à la proximité de mon domicile. Que fait donc la police ? la sûreté des citoyens n’est-elle plus dans ses attributions ? galvan, fabricant.

conseil des prud’hommes.
Séance du jeudi 7 novembre 1833. « Suffit-il de quelques propos entre l’épouse du chef d’atelier chez lequel est un apprenti, et ce dernier pour résilier les engagemens des parties ? – R. Non. » Ainsi jugé entre Chatelin, fabricant, et Duminge, apprenti. Néanmoins les deux parties ont été admonestées par M. le Président du conseil. « Lorsqu’aucune convention n’a eu lieu entre le chef d’atelier et l’apprentie, qui est chez lui à l’essai depuis un certain temps, le conseil a-t-il le droit de fixer le temps de l’apprentissage ou de condamner le père de cette apprentie au remboursement de la nourriture fournie ? – Oui. De combien doit être le temps de l’apprentissage ? – De 4 ans. » Ainsi jugé entre Martin, fabricant, et Charrieux père. Le conseil a fixé à 4 ans la durée de l’apprentissage de la fille Charrieux, entrée le 17 juillet dernier chez Martin ; lesquels courront dudit jour, et à défaut a condamné Charrieux père à payer 50 c. par jour pour la nourriture de sa fille. « Lorsqu’un compagnon va travailler chez son père, y a-t-il contravention contre ce dernier pour l’occuper sans livret, et le père doit-il être condammé à payer le chef d’atelier détenteur du livret ? – » Ainsi jugé pour Guibond, fabricant, contre Roux. La cause majeure de l’audience a été celle de Michel, négociant, contre Carrier, fabricant. Voici les faits : Les livres de Carrier portent une solde d’argent de 255 fr. 55 c. Au mois d’août 1832, Carrier souscrivit à Michel un billet de 50 fr. Il retira son livret sur lequel il fut écrit que le négociant se réservait tous ses droits dans le cas où il serait dû quelque chose. Carrier [3.2]prétend que le billet de 50 fr., souscrit à cette époque, le fut pour solde de compte par suite de montages de métiers, à lui dus, et qu’il est prêt à acquitter le billet qu’on ne lui a, du reste, jamais représenté. Michel prétend que le billet n’a été souscrit que comme à compte. Le tribunal a déclaré le billet nul, a condamné Carrier au payement des 255 fr. 55 c., sauf les indemnités qui pourraient lui être dues, et pour le réglement desquelles les parties ont été renvoyées par devant MM. Joly et Dumas. (Nous reviendrons sur cette affaire au prochain numéro.) Nous avons annoncé le renvoi à aujourd’hui de la cause entre Grillet et Troton, négocians, et Chapeau, fabricant. Le conseil a condamné Chapeau à exécuter la convention. (Voy. le N. 1.) Chevront fabricant, pris en contravention pour avoir occupé l’apprenti de Monavon, a été condamné à lui payer 50 fr. d’indemnité. Martin Hand, apprenti de Fillion, a été pris sous la surveillance de M. Perret, prud’homme, qui lui fixera sa tâche ; et cet apprenti, prévenu de mauvaise volonté, payera les dommages causés à l’étoffe.

Prix pour l’instruction élémentaire. La Société maçonnique du Parfait-Silence nous charge d’annoncer qu’elle vient de fonder trois prix pour l’année 1834, en faveur des écoles d’adultes, dirigées par la Société d’instruction élémentaire du département du Rhône. Le premier prix, composé d’une inscription d’un capital de cent francs sur la Caisse d’épargne de Lyon, sera donné à l’élève adulte ayant fait le plus de progrès pendant l’année, en lecture, écriture et calcul, parmi les élèves qui, lors de leur entrée dans l’école, ne possèdaient aucune notion de ces trois branches de l’instruction primaire. Le second prix, composé d’une inscription d’un capital de soixante et quinze francs, de même nature que la précédente, sera donné à l’élève adulte qui aura fait le plus de progrès pendant l’année, en écriture et calcul, parmi les élèves qui, lors de leur entrée dans l’école, savaient lire, mais ne possédaient aucune notion de l’écriture et du calcul. Le troisième prix, composé d’une inscription d’un capital de cinquante francs, de même nature que les précédentes, sera donné à l’élève adulte qui aura fait le plus de progrès pendant l’année, en calcul, parmi les élèves qui, lors de leur entrée dans l’école, savaient lire et écrire, mais ne possédaient aucune notion de calcul. Ces prix ne seront délivrés qu’à des élèves appartenant à la classe ouvrière, quelle que soit, d’ailleurs, la profession qu’ils exercent. Ces prix seront décernés, dans la séance solennelle que la Société élémentaire indiquera pour la distribution générale des prix, aux élèves de toutes les écoles.

Misères prolétaires. (Suite. Voy. l’Echo des Travailleurs, n. 1). l’enfant qui n’a point de pain. Le jeune Grasse, âgé de sept ans, est assis sur le banc des prévenus. Sa figure serait assez jolie si on ne voyait à ses traits maigres et fatigués, à son teint jaune et pâle, à ses yeux cernés et abattus, que tout jeune qu’il est, il a lutté long-temps déja avec la misère et la faim. Il est prévenu d’avoir volé quelques morceaux de sucre à la boutique d’un épicier. M. le président. – Mon petit bonhomme, pourquoi avez-vous pris du sucre ? est-ce que vous êtes gourmand ? Grasse : – Ah ! non, monsieur ; mais maman ne me donne pas de pain, et j’avais pris ce sucre pour le vendre et pour avoir du pain. M. le président. – Est-ce que vous ne travaillez pas ? Grasse. – Si fait, j’ai travaillé pendant quelque temps à étendre du papier chez un fabricant de papier peint ; mais j’ai été obligé de le quitter quand maman a été à l’hôpital, et depuis je ne gagne plus rien ; on me dit que je ne suis pas encore assez fort pour travailler. La mère du prévenu est ensuite introduite : son extrême maigreur, son teint livide annoncent une vie de souffrance et de privation ; sa tête est entourée d’un mauvais mouchoir de couleur ; sa robe est faite de plusieurs étoffes disparates, et cependant on voit que tous ces vêtemens sont propres ; c’est la misère, mais cette [4.1]misère qui inspire l’intérêt et que le vice n’a pas appelée. M. le président. – Est-ce que votre fils est un mauvais sujet, que vous ne le réclamez pas ? R. Oh ! mon Dieu, non, M. le président ; mais il sera mieux partout ailleurs que chez moi, car je n’ai pas toujours du pain à lui donner. M. le président. – Quel est votre état ? R. Monsieur, je suis frangière : ma fille et moi, nous gagnons dix sous par jour ; et encore nous n’avons pas toujours de l’ouvrage. M. le président. – Mais pourquoi ne cherchez-vous pas à placer votre fille quelque part ? R. Il y a quelques mois, j’ai été forcée d’aller à l’hôpital ; j’ai emmené mon enfant avec moi. On l’a mis aux Orphelins ; mais, quand je suis sortie, on n’a pu le garder. Là, on lui avait donné des douceurs qu’il ne trouve pas chez nous : il avait un lit, et nous couchions, moi, ma fille et lui, sur une paillasse sans couverture ; il faisait plusieurs repas, et chez nous il n’y a pas toujours du pain ; il n’était plus accoutumé à notre vie. J’aurais voulu le replacer chez son ancien maître, mais il n’y avait plus de place : M. le président. – Mais n’êtes vous pas mariée ? R. Je suis veuve, M. le président. Jean-Charles Grasse, mon pauvre homme, était carrier, et, vous savez, c’est un état si traître ! ça vous écrase un homme. Et mon pauvre mari était si bon ! Dieu l’a rappelé. (Elle pleure amèrement). On appelle M. Mazet, fabricant de papiers peints, chez lequel a travaillé le jeune Grasse. M. le président, – Monsieur, vous connaissez cet enfant, il a travaillé chez vous ? R. Oui, Monsieur, pendant quelques mois ; j’occupe une trentaine d’enfans à étendre du papier. M. le président. – Est-ce que vous ne pourriez pas en prendre un de plus ? Vous voyez sa misère. R. Mais si depuis qu’il est sorti de chez moi il a toujours été vagabond, je ne m’en soucie pas. La femme Grasse, vivement. – Non, monsieur, il m’a suivie à l’hôpital, on l’a mis aux Orphelins et ensuite il a travaillé avec moi. M. le président. – Ce sera un acte de grande charité ; d’ailleurs je suis sûr qu’il travaillera bien… Vous travaillerez, n’est-ce pas, mon petit ami ? Grasse, s’essuyant les yeux avec sa manche. – Oui, Monsieur, si on veut me donner de l’ouvrage et du pain. M. Mazet. – Alors je ne demande pas mieux que de l’employer. M. le président. – Femme Grasse, engagez votre fils à travailler ; donnez-lui de bons conseils, puisque vous ne pouvez lui donner que des conseils ; c’est triste pour une mère. Le tribunal renvoie Grasse de la prévention. M. le président. – M. Mazet, vous faites une bonne action et le tribunal vous en félicite. Voila l’un des épisodes nombreux de la vie des prolétaires, et l’on dit que la France est la grande nation, et l’on dit qu’elle marche à la tête des peuples civilisés.

variétés.
Machine à filer le coton. Richard Arkwright l’a inventée en 1769. Métier de bas. William Lea1 en est l’inventeur. Musique. La chanson Veillons au salut de l’Empire, est du citoyen Boy. Tabac. Cette plante de la famille des Solanées est originaire de Tabaco, dans la nouvelle Espagne. Hernandez de Tolède, l’apporta en Espagne, et Nicot2, ambassadeur de France en Portugal, l’envoya en 1560 à Catherine de Médicis, d’où lui vint le nom de Nicotiane, sous lequel il a été long-temps connu. Voitures. Earl Arundel3 a introduit les voitures en Angleterre en 1580. La première qui ait paru à Edimbourg y fut amenée en 1598 par l’ambassadeur anglais. En 1763, une voiture publique fut établie pour le transport des voyageurs d’Edimbourg à Londres ; elle faisait ce trajet en 12 à 16 jours. Aujourd’hui on le fait en 42 heures.

Nouvelles générales. [4.2]– La chambre des pairs et celle des députés sont convoquées pour le 3 décembre prochain. – Les ouvriers chandeliers se sont réunis le 5 novembre à Paris, à la barrière de Fontainebleau ; ils demandent à la fois augmentation de salaire et diminution des heures de travail. – L’autorité avait fait prévenir les maîtres boulangers, que dans le cas où leurs boutiques seraient désertées, elle mettrait à leur disposition les militaires au fait de la boulangerie. – Par suite d’entrevues entre les syndics des maîtres boulangers et ceux des ouvriers, ces derniers ont repris leurs travaux.

Lyon.
Une ordonnance du maire, du 5 novembre, prévient les acquéreurs d’usines en station sur les rivières, que l’emplacement ne doit jamais être pris par eux pour base dans le prix d’achat, attendu que les permissions de stationnement peuvent être révoquées à volonté. – Une autre ordonnance prescrit la réimpression et l’affichage des articles 414 et suivans du code pénal, relatifs aux coalitions. Elle est précédée d’un préambule fort sage, dans lequel le maire interprétant ces articles ne défend que les violences et les voies de fait qui seraient commises par des ouvriers envers leurs camarades. – Les ouvriers charrons se sont coalisés et demandent une augmentation de salaire. – Les garçons perruquiers se sont également coalisés, mais ils attendent que le premier janvier soit passé pour faire connaître leurs prétentions. – Nous apprenons que 45 mandats d’amener ont été décernés à raison de la commémoration funéraire faite dimanche dernier sur la tombe de Mouton-Duvernet ; les citoyens arrêtés, sont, MM. Desgarnier, Galerie de l’Argue, Vincent, liquoriste, rue Raisin, et Thion, instituteur à la Croix-Rousse.

La violence des attaques réitérées de la Glaneuse contre notre rédacteur en chef, ne prouve rien aux yeux des hommes sensés, les seuls dont le suffrage doit être apprécié, elle ne prouve que l’animosité d’un seul homme qui se cache derrière le rideau. En effet, M. Chastaing a été rédacteur de l’Echo de la Fabrique depuis le mois de décembre 1831, et rédacteur en chef depuis le 1er juillet 1832 jusqu’au 18 août dernier. Pendant tout ce temps-là il a vécu en bonne intelligence avec M. Granier et d’autres rédacteurs de journaux patriotes, il a reçu pour sa rédaction les éloges du Précurseur. D’où vient donc aujourd’hui tant d’acharnement ? Sa position n’est pas changée ; de rédacteur en chef de l’Echo de la Fabrique, il devient rédacteur en chef de l’Echo des Travailleurs. C’est donc au nouveau journal qu’on en veut, la chose devient grave, plus grave qu’on ne croit. Nous voulons vivre en bonne harmonie avec la Glaneuse, parce que ses principes sont les nôtres. Nous avons fait tous les sacrifices qui sont possibles ; mais il est une limite que nous ne pourrions laisser dépasser. Le Gérant, Sigaud.

A vendre plusieurs bûches de bois de tremble qu’on a récemment coupées en deux. On les livrera toutes au même prix, ensemble ou séparément. Idem. Un St-Bernard gothique, taillant lui seul sa plume. Il a coûté 1 200 fr. Idem. Les prud’hommes en goguette, ou le flaneur à l’Ile-Barbe. Brochure in-8°. Les prud’hommes remplaceront la jurisprudence fixe par un dîner fixe. Un de ces derniers dimanches, des promeneurs virent une collection de prud’hommes qui jouaient innocemment avec l’her bette.

De la coalition des chefs d’atelier de Lyon, par Jules Favre, avocat. Au bureau de l’Echo des Travailleurs, chez Babeuf, libraire, rue St-Dominique. Brochure in-octavo de 43 pages. Prix : 75 c.

Notes
(boutade sur l’éducation.)
La remarque contraste les profils intellectuels de Benjamin Franklin (1706-1790), physicien, inventeur, à ceux de Claude Saumais (1588-1653) et de Joseph Juste Scaliger (1540-1609), historiens et philologues français.
Notes
(variétés.)
William Lea (1805-1876), inventeur britannique. Jean Nicot (1530-1600), ambassadeur français au Portugal. Il s’agit probablement ici de Philip Howard, 1st Earl of Arundel (1557-1595).
|
|
|
|
|
|
|